Marc Augé, 81 ans, est un monument de la vie intellectuelle. Anthropologue et ethnologue de renommée mondiale, spécialiste de l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique du Sud, il fut directeur puis président de l’EHESS, devenant ainsi le successeur de François Furet, Jacques Le Goff et Fernand Braudel… Par ses études comparées des différentes sociétés humaines, son travail s’attache à démontrer que la modernité a changé de nature. Elle est désormais « sur-modernité » et celle-ci s’incarne particulièrement dans nos lieux de vie. Pour comprendre ce qu’est une ville aujourd’hui, nous ne pouvions imaginer meilleur professeur.
Vous êtes connu pour vos travaux sur les « non-lieux ». Pouvez-vous définir ce concept ?
C’est le contraire du lieu, que j’avais défini comme l’espace sur lequel nous pouvons lire les relations sociales. Il y a une forte charge symbolique dans un lieu et une profondeur historique reconnue, comme par exemple l’église du village ou le monument aux morts qui constitue pour tous un repère historique. Un lieu est identitaire, relationnel et historique. Un espace qui n’est pas identitaire, relationnel ou historique est donc un non-lieu (ainsi des supermarchés, des gares, des
chaines d’hôtels etc. ). C’est un espace de communication, mais sans relations sociales.
 Il n’y a pas de hiérarchie de valeur entre un non-lieu et un lieu car le non-lieu peut être une libération de relations sociales contraignantes pour l’individualité. Au XIXe siècle, les jeunes gens qui quittaient la campagne voyaient par exemple la ville comme un gain de liberté. Dans les villages d’autrefois, chacun apparaissait dans le regard d’autrui et la ville pouvait apparaître comme un lieu d’anonymat.
Il n’y a pas de hiérarchie de valeur entre un non-lieu et un lieu car le non-lieu peut être une libération de relations sociales contraignantes pour l’individualité. Au XIXe siècle, les jeunes gens qui quittaient la campagne voyaient par exemple la ville comme un gain de liberté. Dans les villages d’autrefois, chacun apparaissait dans le regard d’autrui et la ville pouvait apparaître comme un lieu d’anonymat.
La surmodernité, qui porte en elle l’idée de démesure, procède d’une accélération des facteurs constitutifs de la modernité : encore plus d’individualité, une accélération de l’histoire et une surabondance spatiale.
Cependant, les catégories de lieu et de non-lieu ne sont pas des absolus. Il y a du non-lieu dans le lieu et du lieu dans le non-lieu. Dans un non-lieu, on ne connait personne mais on peut faire des rencontres. Prenons l’exemple de l’aéroport. Le voyageur occasionnel suit les panneaux qui lui indiquent où il doit enregistrer ses bagages, ce qu’il fait de manière de plus en plus automatisée. Il voit beaucoup de personnes mais en règle générale il ne leur parle pas. Pour lui, l’aéroport est un non-lieu. Mais pour le voyageur très régulier ou celui qui travaille dans l’aéroport, c’est un non-lieu qui peut prendre des allures de lieu.
En quoi ce concept de non-lieu s’insère-t-il dans un autre de vos concepts, celui de surmodernité que vous préférez à celui de post- modernité ?
La surmodernité, qui porte en elle l’idée de démesure, procède d’une accélération des facteurs constitutifs de la modernité : encore plus d’individualité, une accélération de l’histoire et une surabondance spatiale. Nous avons le sentiment d’être davantage absorbé par l’avenir que poussé par le passé ! Or la pensée symbolique demande du temps et de l’espace.
Ce que l’on appelle globalisation dit bien que le monde est devenu le synonyme de planète pour une immense majorité des habitants de la Terre : c’est un phénomène très récent à l’échelle de l’histoire. C’est ce changement d’échelle qui est caractéristique de notre époque. La Terre devient un objet où les grands financiers peuvent déplacer leurs capitaux d’un bout à l’autre de la planète en un rien de temps.
Cette triple démesure, et l’idéal d’ubiquité et d’instantanéité à laquelle elle est intrinsèquement liée, produit une multiplication des non-lieux. Ces espaces de consommation, de circulation et de communication s’étendent à l’échelle planétaire, donc, à travers les mêmes chaines alimentaires ou les mêmes chaines hôtelières par exemple. La surmodernité produit de l’uniformisation par les non-lieux, ce qui contribue à l’enlaidissement des pays.
Vous parlez de ces espaces de consommation uniformisés qui contribuent à l’enlaidissement du pays. À quoi est-il lié ?
du pays. À quoi est-il lié ?
La France n’est pas épargnée par le phénomène de l’explosion démographique, même s’il est moins marqué que dans d’autres régions du monde. Pour loger un maximum de personnes, nous avons construit dans le désordre ! Le Corbusier rêvait de faire de la maison un univers en soi, sans avoir à trop se déplacer en dehors, mais ce projet, contestable en soi, s’est trouvé dénaturé par la montée du chômage, de l’appauvrissement de la population et de l’insécurité. Cela a notamment eu pour conséquences le départ des commerçants et la destruction de lieux de vie.
L’architecte Huet faisait remarquer que la banlieue était le lieu de l’improvisation. Il avait aussi remarqué qu’elle avait réussi à pénétrer la ville. D’où des zones sans conception d’ensemble. Au total, ce que l’on appelle l’enlaidissement est lié au manque de lieux et de liens, donc de symboles et de relations sociales.
Saint-Denis est un haut lieu de l’Histoire de France. Nous y avons d’ailleurs construit le stade de France. Pourtant, il y a une gêne quand on parle du « 93 » : nous ne pensons plus à ces symboles. Nous avons le sentiment d’une extériorité. Aller dans le « 93 » aujourd’hui paraît une aventure.
Dans les années 1940, on chantait la banlieue : Joinville-le-Pont par exemple, qui était un lieu pittoresque ! La rupture s’est produite dans les années 1970 avec la combinaison de deux phénomènes : le regroupement familial et le chômage de masse. La population a fortement augmenté. On a alors massifié un habitat destiné à l’origine à des travailleurs temporaires. À une situation de ce genre, l’architecte ne peut pas grand-chose car ce n’est pas une question strictement esthétique.
[Il vous reste 50% de l’article à lire]
Merci à Grégoire Crozet pour ses photos. Voir son site et son compte Instagram.
La suite est à lire dans le sixième numéro de la Revue Limite, en vente en ligne et en librairie (liste des 250 points de vente).
Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les quatre prochains numéro (à partir du 8 à paraître en septembre) directement chez vous.



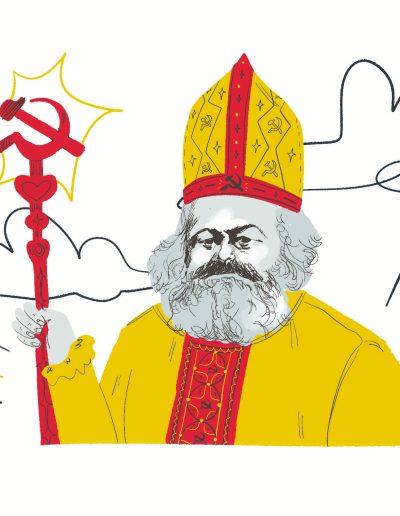
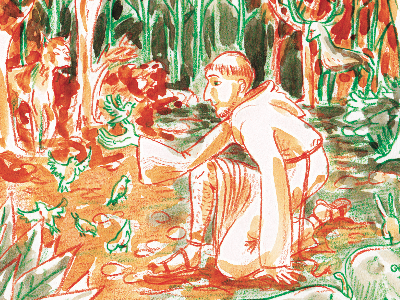

Au fond le « non lieu » est la traduction d’une intuition métaphysique où je sais que ce que je suis n’est pas « quelque part ».
Le refus de la limite, le refus d’être limité, de n’être qu’un moment, qu’une partie, qu’une créature mortelle est le moteur de toute quête spirituelle.
Ce qu’il y a de désastreux dans l’époque est que cette quête se fait collectivement et concrètement en détruisant les identités, les ancrages des personnes qui n’ont rien demandé et qui n’en comprennent même pas le sens.
La post modernité déconstructrice est une religion qui ne dit pas son nom et qui s’impose à tous plus férocement que jamais aucune religion n’avait osé le faire.
Là où la religion catholique vous incitait sans vous forcer et acceptait tous les niveaux de compréhension chez les croyants au prix de passer pour une religion d’imbéciles, la post modernité ne se gêne pas et impose de force sa vérité corrompue à tous.
C’est une religion qui confond les niveaux de réalité et détruit ce qui rendait vivable le temporel au nom d’une utopie qui est le spirituel projeté sur le temporel, l’unité réalisée artificiellement au lieu que ce soit par l’amour divin.
La théorie du genre est typique du spirituel projeté sur le temporel.
Là où saint Paul dit qu’en Jésus-Christ il n’y a plus ni homme ni femme ni juif ni païen etc, l’individu post moderne comprend qu’il faut effacer ce qui nous donné dans le monde pour faire advenir le paradis sur terre.
Cette utopie de révèle et se révèlera un enfer comme toutes celles qui dans l’histoire ont voulu nier le corps.