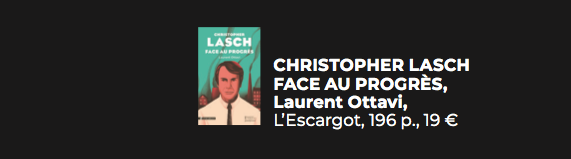Trente ans après sa mort, le sociologue Christopher Lasch laisse une œuvre dense dont la trame principale aura été tissée par une question sur le Progrès : comment se fait-il que cette idéologie ait traversé deux siècles sans jamais être remise en cause ? Plongée dans une œuvre visionnaire, à découvrir dans le dernier numéro de la revue Limite « Débranchez le Progrès ».
PAR LAURENT OTTAVI / ILLUSTRATION DE KÉVIN DENEUFCHATEL
Il y a comme un quiproquo. Le plus souvent, l’idéologie du Progrès est associée aux Lumières françaises. Elle est alors considérée comme un éloge abstrait de la Raison, des arts et des sciences, dont la conquête incessante conduirait à l’amélioration de la condition humaine. Le sociologue américain Christopher Lasch (1932- 1994) lui attribue une autre paternité et un autre sens. Les Lumières françaises, trop utopiques, ne jouèrent à ses yeux qu’un rôle minime dans la genèse de l’idéologie du Progrès – en Angleterre et aux États-Unis, tout du moins – par rapport aux Lumières écossaises et à la science très pratique de l’économie politique du XVIIIe siècle. Il la fait ainsi remonter aux écrits d’Adam Smith (1723- 1790) et de ses immédiats prédécesseurs, David Hume (1711-1776) et Bernard de Mandeville (1670-1733), les pères du libéralisme moderne. Christopher Lasch définit l’idéologie du Progrès comme une promesse d’abondance et de jouissance destinée à s’accomplir ici-bas. Les désirs humains, jugés insatiables car historiques et non naturels, ne seraient pas condamnables en tant que « source de frustration, de malheur et de désarroi spirituel » pour l’individu ou de « corruption et de décadence » pour la société (Christopher Lasch, Le seul et vrai paradis). Ils apporteraient au contraire le bien et la richesse à tous, car, selon la célèbre formule de Bernard de Mandeville, « les vices privés font la vertu publique ».
Better, faster, stronger
L’envie, la cupidité et la vanité, trois manières différentes de nommer la même recherche du « toujours plus », seraient assouvies par la hausse illimitée de la production, aussi appelée aujourd’hui « développement » ou « croissance ». Elles stimuleraient l’inventivité, les richesses, de nouveaux emplois et des standards de confort matériel sans cesse rehaussés.
Un tel programme tient bien plus au sentiment d’un pouvoir illimité conféré par la science moderne qu’à l’éthique protestante, faussement associée à l’esprit du capitalisme par le sociologue Max Weber. Il implique à la fois la centralisation de la production et de l’administration, la division du travail et une surexploitation des ressources naturelles, soit la marche vers des sociétés de plus en plus volumineuses, complexes et énergivores. Il nécessite aussi de se dégager des autorités, et plus largement des contraintes extérieures, qui corsèteraient la liberté plutôt qu’elles ne délimiteraient le cadre lui permettant de se déployer avec mesure. L’émancipation est par conséquent comprise par le libéralisme moderne comme un déracinement.
L’homme deviendrait autonome, c’est-à- dire, étymologiquement, « sa propre loi », à la condition qu’il s’affranchisse des limites inhérentes aux communautés (famille, quartier, Église, etc.), aux traditions, à la nature, aux lieux, à la morale et aux religions. Il serait alors le maître absolu de son destin : un être affranchi du tragique de sa condition. La principale attraction exercée par l’idéologie du Progrès provient de ce décalage entre la largesse de sa promesse, le bonheur pour chacun, et le sacrifice zéro, symbolique ou littéral, qu’elle demande aux hommes…
La suite de l’article est disponible dans la revue n°26 « Débranchez le progrès » à retrouver en kiosque. 98p. 12€