Étymologiquement, la frugalité désigne à la fois la récolte et la modération, la moisson et la tempérance. Reste à savoir comment un repas frugal peut être un vrai régal…
L’un de mes premiers souvenirs d’enfance, c’est l’opération « Sac de riz ». C’était en 1992, j’avais quatre ans. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, avait lancé ce programme pour venir en aide aux habitants de la Somalie touchés par la famine tout en sensibilisant la jeunesse française à l’action humanitaire. Plongé dans la guerre civile, ce pays à la pointe de la Corne de l’afrique subis- sait une sécheresse prolongée qui se surajoutait au chaos social et politique. La famine fit entre 300 000 et 500 000 morts. Le petit écolier que j’étais avait donc dû apporter à l’école communale du Gault-du-Perche (41) un sachet de riz d’un kilo à destination, nous disait-on, des « petits africains qui avaient faim ». Si je me souviens des blagues débiles et franchement racistes qui circulèrent par la suite dans les écoles, je ne sais pas si l’on avait pris le temps de nous parler du défi de la souveraineté alimentaire, ni, plus tard, des conséquences de l’opération, très décriée. Nous nous étions sans doute surtout donnés bonne conscience, et per- suadés que l’Occident pouvait nourrir le monde.
Au moment de commencer ce nouveau dossier, je fus pris (plus encore que d’habitude) d’un profond sentiment d’illégitimité. Il est vrai que je cuisine peu, et que, loin d’être gourmet, je ne suis même pas particulièrement gourmand. Et pourtant, je mange. Trois fois par jour, chaque jour : je n’ai jamais connu la faim. Je le souligne car, hélas, aujourd’hui encore, cela n’a rien d’évident. Outre les famines, ponctuelles, la malnutrition reste un problème structurel. Selon l’ONU, la sous-alimentation progresse à nouveau dans le monde depuis quelques années: plus de 820 millions de nos frères humains souffrent de la faim, deux milliards d’une forme, modérée ou grave, d’insécurité alimentaire. Dans le même temps, un adulte sur huit est atteint d’obésité (l’une pouvant, para- doxalement, favoriser l’autre).
L’expérience du confinement l’a puissamment démontré: quand le cours habituel de nos existences cesse, on revient à l’essentiel. Le consommateur réapprend certains gestes délaissés, redevient producteur, le temps du moins de prendre conscience de son incompétence. Malgré l’inquiétude, malgré la charge du télétravail, beaucoup d’entre nous ont pu prendre plus de temps pour cuisiner, pour lire, pour bricoler, pour semer quelques carottes, pour pétrir leur pain. S’occuper de ses enfants, les nourrir, cultiver: quand l’hypermarché est à l’arrêt, la vie peut recommencer! De mon côté, j’ai passé, je l’avoue, beaucoup de temps au jardin pour essayer cet été d’approcher l’autosuffisance, au moins pour les légumes.
À côté de ces moments (de) privilégiés, la précarité a frappé, sans doute plus durement encore que d’habitude, renforcée par la solitude et la maladie. On a vu s’allonger de manière terrible les files d’attente devant les soupes populaires. La pénurie en France n’a pas eu lieu, mais on l’a crainte, et l’on a vu des ruptures de stock sur des produits de première nécessité: pâtes, œufs, farine, etc. Si certains ont pris du poids à force de grignoter, le mot « pénurie » a refait surface dans le discours commun, même dans nos contrées qui se croyaient sans doute largement à l’abri. Le COVID a réveillé le spectre des ventres vides.
Que ce soit par goût ou par nécessité, cette expérience a sans doute réconcilié nombre d’entre nous avec certains aspects de la vie domestique. C’est tant mieux: qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, la conversion écologique passe par un retour au foyer. Une révolution ménagère qui répartisse plus équitablement les rôles entre les hommes et les femmes et réordonne la fin et les moyens: travailler pour vivre et non vivre pour travailler.
Peut-être est-ce à prix, celui d’une hospitalité radicale, que nos festins seront des fêtes et non pas des orgies.
Ce dossier n’est pas un essai sur la gastronomie, ni un manuel de recettes, ni un mode d’emploi d’agro-écologie. Ou plutôt, il est un peu tout ça, conformément à l’approche transversale de l’écologie intégrale. Vous y lirez des spécialistes et des amateurs, des gourmets, des entrepreneurs, des paysans, des végétariens et des glaneurs. Vous comprendrez mieux à quel point notre alimentation dépend de la santé des écosystèmes. Vous découvrirez comment on peut se nourrir pour presque pas un rond. Vous goûterez un vin naturel et vous initierez au kiviak, une spécialité inuit…
Une certitude unit ces pages: les arts de la table, les traditions culinaires, le plaisir légitime de bien manger, doivent se concilier avec le respect du vivant et le souci de la justice. Être bon vivant est bien plus noble qu’avoir un bon coup de fourchette et de gosier: c’est aimer suffisamment la vie pour vouloir le bien de tout ce qui la sert, ne pas se résigner à ce qu’une jouissance cache son lot de souffrances. Pour que nos plaisirs soient décents, il nous faut connaître le mieux possible comment ce que nous mangeons est arrivé dans nos assiettes, de la production à la distribution. Pour cela, le local est la clef : rien de mieux qu’un potager – ou, à défaut, un marché de petits prOducteurs, une aMaP ou une vente à la ferme. Que les personnes qui nous nourrissent ne puissent pas vivre correctement du fruit de leur travail est une injustice qui devrait nous couper l’appétit.
Les pages qui suivent se veulent un hymne à la table: non pas celle qui engraisse, mais celle qui réjouit. Ne nous y trompons pas : faire bonne chère, ce n’est pas faire ripaille, c’est faire bon accueil! En reprenant cette expression, je n’ai pas fait d’erreur, laquelle serait pourtant significative: écrire « chair » plutôt que « chère », c’est inverser le but et le manière. Le mot « chère » vient en effet du latin cara qui désigne le visage, la face. L’expression n’évoque donc pas le menu d’un bon repas (d’abondantes viandes à la sauce…), mais sa raison d’être la plus profonde, son résultat espéré: provoquer de la joie en rapprochant les hommes, créer de la communion entre les commensaux. À cet égard, un banquet devrait être l’exact opposé d’une banque: un temps de don, de gratuité, d’abondance partagée, qui met à mal les logiques de privatisation et de concurrence. L’évangile va plus loin qui, de Cana à la Cène, nous invite au banquet céleste: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour: cela te sera rendu à la résurrection des justes. » (Luc, 12, 12-14). Peut-être est-ce à prix, celui d’une hospitalité radicale, que nos festins seront des fêtes et non pas des orgies.
[…]
Cet article est l’édito du dossier sur la nourriture du dernier numéro de la revue Limite. Vous pouvez la trouver à la commande en ligne et en librairie !
Si vous aimez Limite, abonnez-vous, il n’y a pas de meilleur moyen pour nous soutenir !



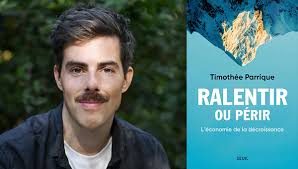


Newsletter svl