Où allons-nous ? » C’est la question que posait Bernard Charbonneau, l’ami de toujours de Jacques Ellul, dans la revue Combat nature en 1984. Cette question, alors, ne se posait pourtant pas. Où allions-nous ? Vers le progrès, pleine balle, chauffe Marcel !
Quarante ans plus tard, un morceau du monde s’est effondré. La biosphère est dévastée, la vie sociale fragmentée. Le ciel est vidé de ses oiseaux, les mers privées de leurs poissons, les champs de leurs insectes, les sols de leurs innombrables habitants, et les travailleurs de leur travail. Quarante ans plus tard, nous savons où nous sommes et pourquoi nous y sommes. Le progrès, qui devait nous libérer de nos chaines, nous a ligoté comme jamais. Malin comme un singe cloné, il a fait de nous nos propres geôliers.
« Avec moi, ça ira mieux ! ». Ils nous le promettront toujours. Mais on sait que le progrès technologique et économique se nourrit de l’instabilité et que la crise est son carburant. « Notre bagnole a un moteur surpuissant, écrivait Charbonneau, il ne lui manque qu’un frein. Ce ne sont pas les innovations qui nous font défaut, mais la possibilité de les assimiler ». Le progrès social, lui, s’érafle à mesure que son double maléfique se consolide. Qui se lève encore pour dire qu’une innovation qui ne permet pas aux gens de s’émanciper n’est pas un progrès ? Dans ce numéro, vous trouverez des hommes et des femmes qui font la différence entre progrès et productivisme, entre amélioration de la vie de chacun et accumulation stérile, qui proposent des alternatives qui ne sont pas des « retours en arrière ». « Entre l’abîme du désordre et celui de l’ordre, nous dit encore Charbonneau, bien plus qu’autrefois le l est mince, il nous faut tenir fermement le balancier. L’écologie fournit le maître mot de la vie, et surtout la liberté humaine : l’équilibre ».
« Mais vous voulez revenir à la lampe à huile ? » Ceux qui aujourd’hui critiquent l’usage irrationnel des sciences et des techniques sont accusés d’obscurantisme et de complicité avec la société amish. Pourtant, tous les scientifiques sérieux s’accordent à dire que la sobriété et la décroissance sont inévitables. Dans ces pages, Jean- Marc Jancovici nous prévient : « Il nous faut inventer un projet de société qui ne repose pas sur la croissance ». L’ingénieur bat en brèche la fascination technophile de nos dirigeants et détruit méthodiquement les idoles.
Une innovation qui ne permet pas de s’émanciper n’est pas un progrès
Chez Limite, blasés par une année électorale vide de sens, nous avons pris à bras le corps ce qui nous tient le plus à cœur : l’écologie sociale. On a fabriqué ce numéro en y mettant ce que nous jugeons le plus essentiel : les gens qui – selon nous – font de la vraie politique. Ceux qui s’approprient leur travail et le font dignement, au quotidien, en montant des fermes, en fondant des coopératives, en accompagnant nos vieux jusqu’à la fin. Ces gens ordinaires, pour reprendre le mot d’Orwell, qui nous semblent beaucoup plus importants que les politiciens qui jouent un mauvais spectacle. Les deux qui ont mis leur tête sur la couverture, quant à eux, ne sont pas des hommes politiques comme les autres. A Versailles comme à Amiens, ils doutent, et naviguent quand il le faut à contre-courant du conformisme ambiant. Il y a quelque chose en eux qui n’est pas mort en entrant en politique, une espérance de voir la « vie vivante » prendre le pas sur le monde des machines.
Le nouveau numéro Limite est disponible en kiosque. Si vous aimez Limite, qu’attendez-vous pour vous abonner ?


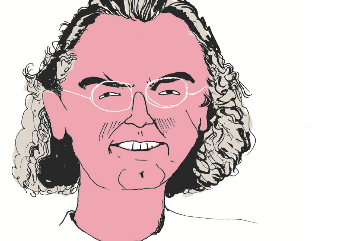


Juste un mot en passant : votre remarquable revue « Limite », au titre stimulant et au contenu crucial, porte en sous-titre : « revue d’écologie intégrale ».
Je comprends bien que cet adjectif « intégrale », ici, renvoie (je pense) à l’idée qu’il s’agit là d’une écologie inclusive et générique, comme une nouvelle vision du monde englobant tous les aspects de la vie et de la pensée, et pas seulement d’une écologie restrictive ne se préoccupant que de préservation de l’environnement (ce qui n’est déjà pas si mal !).
Mais dans « intégral », pour ma part, j’entends comme les échos d’une inquiétante « pureté », comme s’il y avait a contrario une écologie partielle, ou impure. Le mot « intégral » subit la pollution de son voisin lexical, l’adjectif parfois substantivé « intégriste », et je ne peux m’empêcher d’y ressentir comme un certain refus de la nuance et de la réflexion libre, de la déviance potentielle… soit l' »intégralité » au risque du dogmatisme et de l’exclusive, comme on pourrait l’entendre aussi d’une écologie « radicale ».
C’est pourquoi je préfèrerais le terme d’écologie « fondamentale », car il s’agit bien en effet de changer de paradigme, de reprendre l’ouvrage jusqu’aux fondations dans une optique « constructive », de revoir les fondements de notre civilisation et plus : de notre vision du monde, de refonder notre rapport au monde et surtout au vivant. Qu’en pensez-vous ? Que vouliez-vous dire en mettant en exergue une écologie « intégrale » ?
Complément au commentaire précédent :
Pour ma part, je serais assez « techno-critique », [comme le propose Alain Damasio (« Les Furtifs », ou « Scarlett et Novak »)], et profondément favorable à la reconnexion au vivant (Baptiste Morizot, entre autres : « Manières d’être vivant », postface de Damasio), mais pas « technophobe » (nuance qu’on trouve encore chez Damasio) : en effet, je pense qu’il importe de distinguer les progrès « utiles » —utiles à ce qui humanise l’humanité (au sens éthique d’abord), et utiles au vivant dans son ensemble—, et de les différencier des progrès « dangereux » pour les mêmes instances (l’humanisation et le vivant) ; soit dangereux immédiatement (comme les armes sophistiquées, par exemple, pour toujours plus et mieux tuer, si ce n’est que la tendance à l’auto-prédation de l’homme a pour avantage de limiter un peu sa pullulation, mais ce n’est pas une excuse !) ; soit dangereux à terme par leurs effets secondaires pervers. Le criticisme en l’occurrence serait ce qui permet de multiplier les critères d’évaluation d’une innovation pour tenir compte de tous ses effets induits, y compris systémiques.
Progrès utile/progrès dangereux : par exemple, aucune étoile, aucun organisme vivant, ni aucune civilisation humaine (même la plus sobre possible et souhaitable) ne peuvent exister sans consommer de l’énergie : donc tout progrès théorique et technique qui permettrait de gérer une véritable renouvelabilité de l’énergie et une diversification de ses sources, en minimisant, en diluant et en différant au maximum l’entropie induite (c’est-à-dire qui ouvre et interconnecte le plus possible le système), ne pourrait qu’être favorable, je pense, à la préservation du vivant. Après tout, la vie est un des rares phénomènes néguentropiques observables, et elle a encore beaucoup à nous apprendre dans le fondamental… La science et la connaissance profonde du réel irréductible n’ont pas dit leur dernier mot, et ne sont pas inévitablement toujours à l’origine d’une catastrophe. Elles ne sont pas forcément incompatibles avec une meilleure insertion dans la biosphère globale. La question devient alors : comment décroître sans s’autodétruire ? Et aussi : comment se reconnecter au vivant avant ses échéances catastrophiques, pour les atténuer autant que possible ?
Ce qui m’intéresse le plus dans notre/votre revue « Limite », c’est qu’elle constitue un cadre, un champ de recherches et presque un « écosystème » à la confluence de plusieurs sagesses ancestrales et courants de pensée novateurs, dans lequel peut s’élaborer l’ensemble des critères permettant cette distinction subtile entre progrès utile et progrès dangereux. Comme une sorte de « comité bioéthique » de la pensée innovante ?…
Car je ne crois pas que nous soyons à la veille de la fin du monde, ni de la fin du vivant ni même de la fin de l’homme : le cerveau humain fait lui aussi partie des merveilles de la nature et des miracles de l’évolution, et il mérite lui aussi d’être sauvé, merdalor !!! Mais il nous faudra redoubler de créativité « intelligente » plutôt que débridée, c’est-à-dire tout sauf mégalomaniaque, extractiviste-destructiviste et prométhéenne ; il faudra en rabattre sur la volonté obsessionnelle d’artificialisation généralisée du système global… car, ce me semble, l’histoire de Prométhée finit mal, surtout pour lui…
PS : encore une fois : à quand une longue interview d’Alain Damasio sur tous ces sujets dans vos colonnes ? À moins que vous ne l’ayez déjà invité dans un numéro plus ancien : lequel, alors, que je puisse l’acheter de ce pas ? Et j’attends avec impatience votre prochain numéro d’automne…