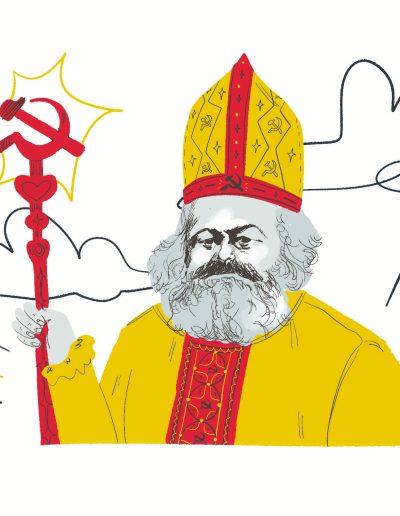Pendant 14 mois, Mayeul Jamin est parti sur les routes découvrir des collectifs alternatifs. Cet autodidacte, qui travaille actuellement en arboriculture bio, a raconté ce tour de France dans un beau livre, plein de rencontres enthousiasmantes, qui l’ont poussé à fonder la communauté Sainte-Angèle. Il prolonge la réflexion sur la place des chrétiens dans la société : ferment dans la pâte ou force révolutionnaire ?
Illustration : Mayeul Jamin.
« « Sortir du système » semble être devenu le dernier sport à la mode », écris-tu dans l’avant-propos de ton livre. Est-ce vraiment l’objectif des gens dont ton livre fait le portrait ?
Mayeul Jamin : Je ne crois pas qu’on puisse parler de « sortir du système » – ou du « dispositif », comme le nomme Fabrice Hadjadj dans sa préface, sans doute pour éviter le slogan facile – comme finalité absolue de l’action et de la pensée des personnes que j’ai rencontrées. Je pense que c’est plutôt vu soit comme un moyen, soit comme une conséquence d’une finalité plus grande.
C’est sans doute pour dénoncer le slogan que j’écrivais ceci. Parce que finalement, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, non ? Qu’est-ce que « le système » ? Chacun y met ce qu’il veut, selon ce qu’il rejette, puisque presque tout le monde semble s’accorder à dire que ce n’est pas terrible, le système. Mais il y a toujours un système, des systèmes qui cohabitent ou se font la guerre ! Et finalement, être « anti-système », c’est également rentrer dans une sorte de système.
Au départ, je voulais écrire un chapitre pour expliquer ce qu’était le système, mais j’ai buté sur quelques obstacles avant de décider de fuir devant la complexité de l’exercice. Mais la préface, bien plus finement que je n’aurais pu le faire, donne de bons éléments de réponse à cette question.
Entre Germain et Massoud, entre Josué et Ségolène, entre une ZAD et un monastère tradi, on pourrait dire qu’il y a un monde ! Pourtant, qu’est-ce qui les relie ? Quel monde commun partagent-ils tous ?
Entre les cases dans lesquelles on est toujours tenté de ranger les gens, il y a la vie ! Voilà ce qui relie fondamentalement toutes les personnes que j’ai rencontrées : la recherche de la vie. Je parle bien de « recherche » et non simplement de « préservation » ou de « conservation » de la vie, et c’est à dessein. Car on a parfois la tentation de préserver la vie à tout prix, au détriment de la vie elle-même – les derniers mois en sont à mes yeux une preuve assez flagrante[1]. Et la vie englobe et accueille le bonheur, le partage, la relation, mais aussi le drame, la violence, la maladie, la mort ; tous ces évènements qu’on ne peut pas prévoir, ou qui du moins nous apparaissent toujours comme une éternelle nouveauté, malgré leur prévisibilité déconcertante.
Je pense pouvoir dire également que ce qui relie toutes ces personnes, c’est de chercher à mener une vie authentiquement humaine. C’est une de mes grandes découvertes de ces dernières années, d’abord lors de mon tour de France puis lors de mon année de formation à l’institut Philanthropos : la conversion écologique est d’abord une question anthropologique[2]. Ce qui importe, avant de « sauver la planète » en tentant de « réduire nos émissions carbone », c’est de comprendre ce qu’est l’homme et de chercher à l’incarner concrètement, ce qui passe par le travail des mains et remettre au centre le foyer, l’oikos. Je crois que c’est ce que font les personnes que j’ai rencontrées, chacune à sa manière, à son rythme.
Enfin, les personnes que j’ai rencontrées sont toutes en quête de véritables relations. Cela va d’ailleurs à l’encontre de ce que beaucoup peuvent imaginer à propos des milieux alternatifs écologistes, qui sont souvent vus comme des personnes recherchant une forme d’autarcie extrême et qui, pour s’en protéger, se garderaient à distance de leurs semblables. Non, la majeure partie de ceux qui prônent une sobriété heureuse intègrent totalement la relation dans leur mode de vie ! Cela se traduit par la mise en place de réseaux – de travail, de solidarité, artistiques, etc. J’ai découvert des gens qui mettent en commun leurs outils de travail et leurs savoir-faire, une partie de leurs biens, qui se retrouvent pour faire ensemble, pour danser, chanter et jouer. Qui cherchent à être en relation avec leur environnement naturel, avec la Création. En relation souvent avec quelque-chose ou quelqu’un qu’ils savent plus grand qu’eux sans toujours savoir le nommer. Des gens qui travaillent pour la « connaissance de soi », comme le dit Lanza del Vasto, qui cherchent la paix et la vie intérieure.
Ce sont des personnes qui, sans forcément le savoir, vivent à leur manière une écologie intégrale, définie par le Pape François dans Laudato Si’ comme « relation à Dieu, à soi, aux autres et à la Création ».
La vie, l’humanité, la relation. Tout un programme !
Beaucoup d’expériences communautaires radicales démarrent en trombe, avant d’imploser ou de dégénérer. As-tu pu entrevoir quelques critères de pérennité dans tes rencontres ?
C’est une question délicate, à laquelle je n’ai pas la prétention d’apporter de réponse. En effet, comme tu le dis dans la question, je crois que les deux risques auxquels sont confrontées les communautés humaines sont l’implosion et la dérive sectaire – la seconde étant sans doute pire que la première et aboutissant tôt ou tard à la première. Je viens de lire le livre absolument passionnant du prieur de la Grande Chartreuse, dom Dysmas de Lassus, Risques et dérives de la vie religieuse. Il analyse dans ce texte les dangers qui guettent en fait non seulement les communautés religieuses – qui ont un certain nombre de spécificités qui rendent ces dérives plus difficilement détectables –, mais plus généralement toutes les communautés humaines : le repli sur soi, l’admiration démesurée du fondateur, les défauts d’autorité ou de règle (trop ou trop peu), les défauts de relation ou de communication, l’idéalisation d’un mode de vie ou la négation du réel… Lister ces quelques risques permet sans doute de prendre conscience des lieux d’attention particuliers qu’il faut avoir lorsque l’on mène une expérience communautaire.
Ce que je constate dans ma toute petite expérience, c’est que les communautés qui durent sont celles qui ont la conscience d’une transcendance, c’est-à-dire une ouverture à plus grand que soi, une verticalité ; c’est à mes yeux une condition non pas suffisante mais nécessaire. Et qui dit transcendance dit nécessité de suivre une loi, quelle qu’elle soit : loi naturelle, loi divine, une « conscience universelle » comme le dirait le boulanger breton Daniel, premier à avoir subi mes questions lors de mon tour. Ceci afin que nos actions rentrent dans le cadre, le respect de cette transcendance. La loi n’étant pas dans ce cas une injonction arbitraire mais le fruit d’un dialogue permanent avec cette transcendance.
Ensuite, bien évidemment, les communautés qui durent sont celles où la communication entre les membres n’est jamais rompue trop longtemps (personne n’est à l’abri du conflit, mais si celui-ci dure trop, alors tout finit par s’effondrer). Je pense aussi qu’il y a une notion d’équilibre, toujours à retrouver, entre le travail et la fête, entre l’activité et la vacance, l’un et l’autre étant en continuité et non dichotomique.
Et enfin, mais nous en reparlerons plus tard, la nécessité absolue d’éviter le repli sur soi – personnel et communautaire. Car bien que faire le choix de modes de vie radicaux entraîne nécessairement une forme de prise de distance avec le monde, il ne faut jamais que ce soit une rupture totale.
« Pas de replâtrage, la structure est pourrie ! », lançaient les soixante-huitards. As-tu aujourd’hui à l’égard de notre modèle économique et social ce même sentiment ?
A première vue, je répondrais qu’en effet, le modèle actuel est pourri. Je crois que le capitalisme contient en lui-même ses propres dérives, à l’inverse de ceux qui affirment qu’il existe un capitalisme vertueux. Si on parle du péché originel, comme le fait Lanza del Vasto, comme l’esprit de possession, de profit et de domination, j’aurais tendance à voir le capitalisme comme l’application économique du péché originel. Je ne suis ni théologien, ni philosophe, ni économiste, j’aurai donc une grande difficulté à développer beaucoup mes réponses à cette question. Mais j’ai la chance d’être entouré par des personnes qui ont ce talent, je pense notamment à Alexis Guénez qui a récemment écrit dans vos pages et qui travaille une thèse sur le distributisme de Chesterton, qui a pour objectif de proposer une économie à visage humain, une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme.
Par ailleurs, on peut dire que notre modèle social français est l’un des plus avantageux dans le monde actuel, et c’est sans doute vrai. Mais je me questionne sur un système qui d’un côté produit de la misère et des inégalités pour entrer de l’autre côté dans une logique d’assistanat social envers ceux qu’il a laissé sur le bord du chemin ; et qui par ailleurs entretient une forme d’individualisme généralisé qui nous permet de passer devant des clochards en détournant le regard. Il suffit de se balader dans les rues de nos grandes villes en levant les yeux de nos smartphones pour constater l’échec de notre modèle économico-social.
Par contre, pour contrebalancer la première partie de ma réponse, je pense essentiel d’affirmer que nous pouvons toujours faire du bien là où nous sommes. Même si on considère évoluer dans une structure de péché, il nous reste toujours la liberté de choisir le bien ! Je travaille par exemple en ce moment dans une entreprise arboricole gérée par deux frères qui ont converti en bio les cultures héritées de leurs parents, qui ont une relation magnifique avec leurs employés, qui logent absolument gratuitement les plus défavorisés d’entre eux car ils considèrent que le salaire qu’ils peuvent verser ne leur suffirait pas pour vivre décemment. Tout cela dans le cadre d’une entreprise, du salariat, du capitalisme – cadres qu’ils acceptent par ailleurs tout-à-fait de questionner avec moi. Ces gens-là font objectivement du bien ! Et le monde est rempli de personnes comme cela, qui font du bien sans faire de bruit, sans chercher visiblement à sortir du cadre.
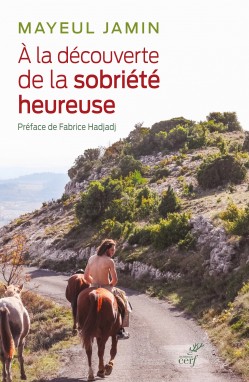
Mayeul Jamin, À la découverte de la sobriété heureuse, 448 pages, 2019.
A ton avis, quelle place les chrétiens doivent-ils assumer dans la société aujourd’hui : ferment dans la pâte ou force révolutionnaire ?
Faut-il vraiment opposer les deux ? N’est-ce pas une sorte de révolution que fait advenir le levain dans la pâte ?
Je peux peut-être reprendre ici ce que j’avais simplement commencé à évoquer dans ta question sur les expériences communautaires : le danger du repli sur soi. Je crois que les chrétiens doivent aujourd’hui se regrouper en communautés de vie, pour se soutenir mutuellement dans leur foi, dans leur conversion personnelle et intérieure, dans leur transition écologique ; et dans tout cela, pour continuer à exister en tant que chrétiens. La communauté est un des lieux où la relation peut le mieux se déployer, car nous sommes en permanence et radicalement confrontés à l’autre, et nous ne pouvons pas fuir. Mais si nous nous arrêtons là, nous restons dans une logique de « préservation de la vie » chrétienne. Mais à quoi sert de préserver la vie si c’est pour la mettre sous cloche ? La vie se préserve pour se donner ! Ce que nous avons, nous ne pouvons le garder pour nous, il nous faut le transmettre, il nous faut rayonner. Nos communautés doivent être des tremplins pour l’évangélisation, et non des bastions survivalistes. Certains voient la communauté comme l’entre-soi – et soit la prônent pour cela, soit la rejettent au nom de la nécessité de vivre avec les autres. Je pense pour ma part que la communauté est la condition de notre rayonnement. Il suffit de regarder dans la Bible : les premiers chrétiens vivaient ensemble, mettaient tout en commun, et ils ont évangélisé le monde ! Ce n’est pas par les moyens de communication digitale, ni par des techniques publicitaires qu’ils l’ont fait, c’est par leur témoignage de vie – car même les missionnaires sont envoyés par leurs communautés.
Cela me fait penser aux communautés de l’Arche de Lanza del Vasto, dans lesquelles l’action civique non-violente fait partie des engagements : un Compagnon de l’Arche n’est envoyé en mission à l’extérieur qu’après plusieurs années de vie communautaire et de travail sur soi. Parce que le premier à convertir, c’est moi-même ; parce que le témoignage passe d’abord par les actes et non par les discours.
Reprenons l’image du levain. Je fais chaque semaine une dizaine de kilos de pain au levain pour ma maison et ses membres. Le levain n’est fait de rien d’autre que d’eau et de farine, comme le pain. Mais si je mélange de l’eau et de la farine puis que j’enfourne directement la pâte, cela ne donnera rien de mangeable. Comment cela se fait-il que mettre un mélange d’eau et de farine dans un autre mélange d’eau et de farine donne du pain ? C’est que j’aurai au préalable mis à part le premier mélange, en aurai pris soin, l’aurai laissé mûrir, « révolutionner », et fermenter pour qu’il puisse, au bout d’un certain temps, ensemencer le reste de la pâte. C’est ce que fait Dieu avec nous, la communauté chrétienne, et le monde.
En faisant cela, nous prenons la distance nécessaire avec le « système » en choisissant un mode de vie de fait décalé avec celui qu’il essaie de nous imposer, nous construisons autre chose, et en ce sens sommes « révolutionnaires » ; et dans le même temps, nous sommes le levain dans la pâte, car notre rayonnement a un impact sur le monde et participe aux changements nécessaires. A la fois de l’extérieur et de l’intérieur. Dans le monde, mais pas du monde.
Cet entretien est paru sous une forme abrégé dans le numéro 22 de Limite. Retrouvez ce numéro sur le site de notre éditeur !
[1]Lire à ce propos la dernière publication d’Olivier Rey, L’idolâtrie de la vie, Tracts Gallimard.
[2]https://etsictaitpossible.com/2020/10/05/la-conversion-ecologique-est-dabord-une-question-anthropologique/
- François Ruffin & François-Xavier Bellamy : Leur ennemi en commun - 05/30/1998
- L’édito écolo : « L’instrumentalisation de la question climatique par les politiques et industriels rappelle l’importance du projet d’écologie intégrale » - 05/30/1998
- « La communauté est la condition de notre rayonnement » - 05/30/1998