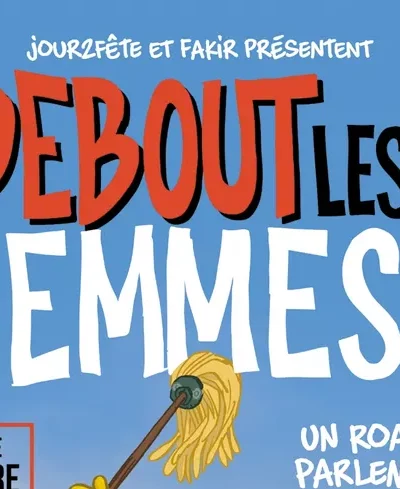Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations, François Gemenne est chercheur à l’Université de Liège (Belgique). Il est aussi co-directeur de l’Observatoire Défense et Climat du Ministère des Armées (France), établi à l’IRIS. Auteur principal pour le GIEC, il enseigne les politiques du climat et les migrations internationales dans plusieurs universités, notamment à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Avec Limite, il explore les contours d’une géopolitique climatique.
Entretien mené par Gaspard Chameroy
Illustration de Charlotte Guitard
Limite : En quoi l’enjeu des changements climatiques est un sujet géopolitique ?
François Gemenne : C’est LE sujet géopolitique par excellence. La géopolitique a été définie de longue date comme l’étude des rapports de puissance. Aujourd’hui, nous avons besoin de redéfinir ce champ, en concevant que la terre est aussi un acteur politique. Notre manière de l’habiter est en train de profondément la changer, c’est l’Anthropocène. Ce terme désigne une nouvelle ère géologique dans laquelle l’homme a acquis une telle influence sur la biosphère qu’il en est devenu l’acteur central. Si nous voulons comprendre le monde, ce qui est le but de la géopolitique, il faut passer des relations internationales aux relations globales, et considérer non plus seulement les rapports entre les nations, mais aussi avec le vivant.
À quel moment avez-vous pris conscience de la dimension géopolitique du climat ?
Certains ont une prise de conscience en contemplant des forêts qui disparaissent ou des glaciers qui fondent, moi je l’ai eu en voyant le concept de souveraineté vaciller. L’électrochoc a été de réaliser qu’il était possible que certains États perdent leur territoire, et notamment les États insulaires, à cause d’actions entreprises par d’autres à l’autre bout de la planète, et ce sans y avoir prise. J’ai eu l’occasion d’habiter à Tuvalu, un archipel polynésien dans l’ouest de l’océan Pacifique Sud. C’est un des plus petits États du monde qui perd son territoire non pas à cause d’un problème politique mais à cause des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce genre de situation bouleverse le concept de souveraineté nationale. Qu’est-ce que cela veut encore dire si mon État se dérobe sous mes pieds à cause de l’action d’autrui ? Peut-on imaginer des États déterritorialisés ?
Selon vous, que nécessite cette remise en cause de la souveraineté des États ?
Il faut un vrai travail de redéfinition des frontières. Une frontière est un marqueur d’identité, avec un groupe au sein duquel nous reconnais- sons une forme de solidarité particulière. À cause des inégalités climatiques, les pays les plus responsables de la catastrophe en cours n’ont pas un intérêt direct à ce que cette catastrophe s’arrête, si on la conçoit dans ses frontières. Or la question de l’action écologique se pose en termes moraux. Le Pape François l’a tout à fait compris en publiant l’encyclique Laudato Si. Il s’agit de se sentir responsable de ce qui concerne ceux que nous ne connaissons pas. J’aimerais que nous nous sentions responsables de ce qui se passe à Tuvalu. Le prérequis est de considérer que les seules frontières qui vaillent vraiment sont planétaires.
Comment dépasser ces frontières dans la gestion des problèmes climatiques ?
Dans ces débats sur l’universalisme, l’enjeu est de considérer qu’il y a un impératif d’égalité qui doit dépasser nos frontières. L’idéal universaliste sera atteint dès qu’on considérera que ceux qui habitent au-delà de nos frontières sont nos semblables au sein d’une même humanité et non aux limites de la métropole. Un des problèmes est que les gouvernements sont arc-boutés sur leurs champs nationaux. Sur les questions climatiques, chacun affirme fièrement ce qu’il va faire chez lui dans des engagements nationaux. L’enjeu n’est pas chez soi, mais au niveau global. Les discussions se concentrent sur les gros émetteurs : la Chine, les États-Unis. Demain la lutte va se jouer en Égypte, en Iran, en Afrique du Sud, dans des pays qui risquent de devenir de grands émetteurs. Il y a une nécessité de remettre au goût du jour les objectifs de coopération internationale sur ces sujets, au risque d’être condamnés à des déceptions permanentes.
Pourquoi la gouvernance climatique mondiale est-elle difficile à construire ?
Les pays ont tous tendance à agir en fonction de leur intérêt national. Ils ont compris intellectuellement mais pas politiquement qu’il était dans leur intérêt commun d’agir ensemble. Pourtant, en s’engageant trop, les pays seront toujours accusés de brader leurs sujets nationaux. Il y a un enjeu culturel : le nationalisme est le principal ennemi du changement climatique, devant le pétrole ou le charbon ! […]
Retrouvez le dossier climat dans notre dernier numéro. Le numéro 23 est à commander dans toutes les bonnes librairies ou en ligne sur le site de notre éditeur. Si vous aimez Limite, qu’attendez-vous pour vous abonner ?

- Monique Pinçon-Charlot – « l’effondrement n’est dû qu’à la recherche perpétuelle du profit » - 05/30/1998
- François Gemenne : « La catastrophe climatique va bouleverser la souveraineté nationale » - 05/30/1998
- Monique Pinçon-Charlot : « L’effondrement n’est dû qu’à la recherche perpétuelle du profit » - 05/30/1998