Poursuivant son analyse des soubassements idéologiques de la science moderne, notre ami Olivier Rey, chercheur au CNRS, vient de publier un nouvel essai important, Leurre et malheur du transhumanisme (DDB, octobre 2018). Avec son érudition et sa clarté habituelles, il nous révèle ce que le marketing transhumaniste cherche à dissimuler derrière sa vitrine mirobolante : l’homme « augmenté » n’est que le produit d’un monde ravagé.
D’où vient le désir transhumaniste ?
Après avoir montré comment le leurre des promesses transhumanistes détourne l’attention de ce qui se joue dès à présent, Olivier Rey s’attache à caractériser ses ressorts. Il identifie ainsi deux « sources de vulnérabilité à l’égard de l’idéologie transhumaniste » : « d’une part, la situation « diminuée » de l’individu contemporain, qui lui rend les perspectives d’ « augmentation » séduisantes ; d’autre part, le cadre de pensée hérité de la modernité, dont le transhumanisme est à sa manière un aboutissement ».
L’auteur analyse d’abord les complexes de l’individu contemporain, qui, bien que convaincu de sa supériorité par rapport aux hommes du passé, s’avère, bien plus qu’eux, « rongé par le sentiment de son insuffisance ». Il ne s’agit évidemment pas de nier les bénéfices certains des évolutions apportés par les derniers siècles, « tant sur le plan matériel qu’en ce qui concerne la liberté individuelle », mais de « prendre aussi en considération les pertes occasionnées ». Qu’il s’agisse de l’effondrement de la biosphère – sixième extinction de masse, chaos climatique, pollution généralisée… – ou de la dissociété, « revers de la satisfaction donnée aux aspirations individuelles », qui frustre tout un chacun de ses « instincts communautaires ».
Le bilan de la modernité est, pour l’auteur, globalement « problématique ». « La vérité est que jamais les êtres humains réduits à leurs seules forces n’ont été aussi impuissants, impotents – non seulement parce que les facultés naturelles, non cultivées, ont décru [ainsi du sens de l’orientation ou de la mémoire], et que les savoir-faire fondamentaux [cultiver son jardin, par exemple, ou coudre un vêtement] n’ont plus été transmis, mais aussi parce que l’organisation générale réduit ce que les capacités propres permettent d’accomplir à presque rien. » La marche ne nous suffit plus pour vaquer à nos occupations quotidiennes, nous dépendons de véhicules, individuels ou collectifs, pour travailler, nous nourrir, nous divertir, voir nos proches – avec tous les problèmes d’embouteillage, de pollution, d’artificialisation des terres, etc., que cela pose.
Quant aux prothèses technologiques, il suffit d’ouvrir les yeux pour prendre conscience de leur caractère moins émancipateur qu’envahissant, sinon liberticide : présenté comme un plus, destiné à faciliter la vie, internet est rapidement devenu un tout, absorbant une part croissante des interactions ordinaires. De même, ne pas être équipé de smartphone vous expose aujourd’hui à vivre à une forme de marginalité sociale et professionnelle. « En témoigne la part grandissante, « contrainte », de la technologie dans le « budget des ménages », au détriment de l’alimentation qui s’ajuste à la baisse, le branchement au réseau se fait plus vital que la nourriture elle-même. » Et Olivier Rey d’ajouter : « Le transhumanisme ne cesse d’en appeler à l’imaginaire de la souveraineté individuelle, mais ne laisse présager qu’une radicalisation de l’aliénation. »
Or, l’effondrement écologique auquel nous commençons à faire face pourrait bien transformer cette artificialisation de nos vies en nécessité vitale. C’est d’ailleurs l’idée même du cyborg (pour cybernetic organism), notion apparue en 1960 : « modifier les fonctions corporelles de l’homme pour répondre aux exigences des environnements extraterrestres » – ou à ceux des environnements terrestres rendus inhospitaliers par les dégâts que nous leur infligeons. « Plutôt que d’augmentations, il faudrait alors plutôt parler de kits de survie en environnement hostile. »
Du scientisme au transhumanisme
Mais à cette « situation diminuée de l’individu contemporain » se conjugue l’évolution de la pensée scientifique elle-même. A travers elle, pour Olivier Rey, le transhumanisme se révèle être « l’horizon de la modernité ». C’est à cette analyse épistémologique qu’est consacrée la moitié de l’ouvrage, plus philosophique. L’auteur montre comment la science a peu à peu changé de finalité, passant de la compréhension à la transformation. Revenant sur la querelle médiévale du nominalisme, il note : « Si la faculté suprême est l’entendement, la science aura pour fin ultime la theoria, la contemplation : si la faculté suprême est la volonté, la science aura pour fin ultime le pouvoir qu’elle donne sur le monde. » Cette évolution est, pour Olivier Rey, la matrice du projet moderne de domination technique sur la nature, qui culmine avec le positivisme du XIXe siècle et se poursuit aujourd’hui avec le transhumanisme.
Pour mettre en valeur ce continuum, l’auteur exhume de longs passages surprenants d’Ernest Renan, « sorte d’idole de la IIIe République naissante ». Dans l’un de ses Dialogues philosophiques (1876), Renan écrit : « De même que l’humanité est sortie de l’animalité, ainsi la divinité sortirait de l’humanité. Il y aurait des êtres qui se serviraient de l’homme comme l’homme se sert des animaux. » Ces êtres, nouveaux maîtres d’une humanité à dompter, ressemblent à s’y méprendre aux « augmentés » (upgraded) que Kevin Warwick, professeur de cybernétique à l’université de Reading, « et premier humain à s’être fait implanter une puce », travaille à faire dominer les « simples humains qui ne représenteront plus, par rapport à eux, que les chimpanzés du futur » (cf. I, Cyborg, 2002).
A ces « contes sur le triomphe de l’intelligence artificielle », à ces fantasmes transhumanistes qui ne doivent pas nous masquer ce qui se passe, réellement, ici et maintenant, sous nos yeux, Olivier Rey oppose une résistance, qui relève à la fois de la démystification (notamment lorsqu’il rappelle que l’épuisement des ressources risque de mettre rapidement un terme à la fuite en avant technologique) et d’une sagesse fondée sur la non-puissance, la convivialité (au sens d’Ivan Illich) et la lucidité. Nous n’épuiserons pas ici les nombreuses et denses réflexions de ce livre passionnant, dont nous n’avons donné qu’un rapide aperçu, mais nous conclurons avec l’auteur, non sans gravité :
« Pour être à la hauteur de ce qui vient, ce ne sont pas d’innovations disruptives dont nous avons besoin, de liberté morphologique ni d’implants dont nous aurons besoin, mais de facultés et de vertus très humaines. »

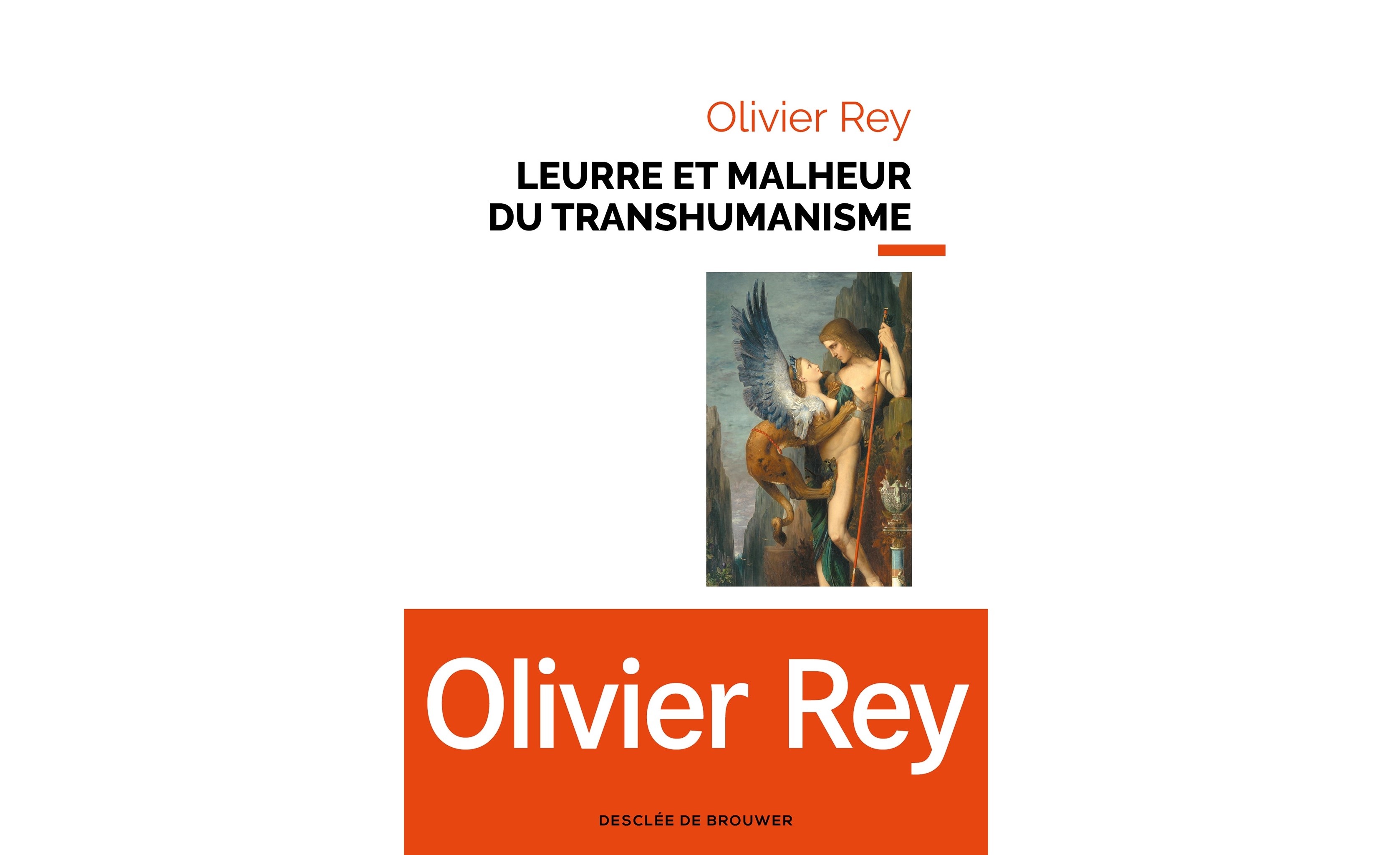



« Pour être à la hauteur de ce qui vient, ce ne sont pas d’innovations disruptives dont nous avons besoin, de liberté morphologique ni d’implants dont nous aurons besoin, mais de facultés et de vertus très humaines. »
Est-il humain ou supra humain de résister à la tentation?
Et quand c’est la tentation du Bien?
Frodon parvient à rejeter l’anneau de puissance dans l’abîme d’où il vient au lieu de l’utiliser pour le « bien ».
Qui d’autre qu’un enfant le peut?