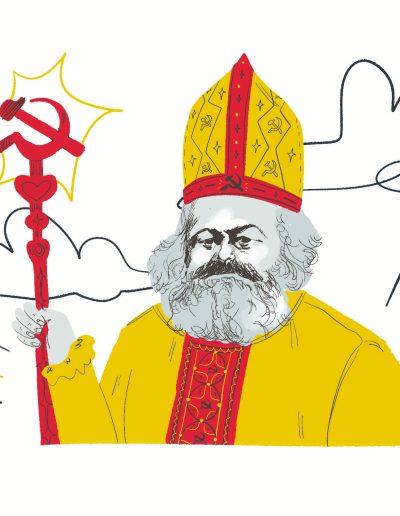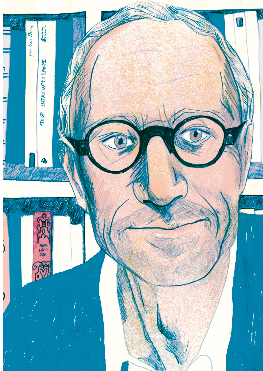
Face à l’idée selon laquelle la bonne manière de vieillir serait de « vieillir jeune », le sociologue Michel Billé conçoit la vieillesse comme une période de la vie qui offre la puissance de se mobiliser pour un monde meilleur et qui, dans le même temps, permet la joie de la transmission.
Propos recueillis par Antonin Gouze / Illustrations de Charlotte Guitard
Vous avez travaillé sur la notion de « bienvieillir, qui est selon vous une idéologie qui vise à faire croire que l’on peut « vieillir et rester jeune ». Pourquoi est-ce faux ?
Cette idée de bienvieillir est bienvenue, au premier abord. Nous ne connaissons pas une seule personne qui aurait envie de vieillir mal. Tout le monde, à priori, veut vieillir bien. Cependant, l’usage que l’on fait aujourd’hui de cette notion de bienvieillir me semble complètement fou. Petit à petit se constitue une injonction paradoxale qui rend fou et malade les personnes auxquelles elle s’adresse. Cette injonction nous dit : « Vous avez le droit de vieillir, à condition de bien vieillir ». Comme si nous choisissions, comme si notre vieillesse n’était pas le résultat de ce qu’a été notre vie.
Or, nos vies sont différentes selon que l’on est né homme ou femme, dans une famille aisée ou moins aisée, nombreuse ou peu nombreuse, que l’on ait été ouvrier ou cadre. Tout ceci détermine nos manières de vieillir et aura une influence non seulement sur notre espérance de vie, mais aussi sur la qualité sur ce que nous allons vivre en devenant vieux.
Le bienvieillir est donc devenu petit à petit synonyme de vieillir « en bonne santé », « en pleine forme », et véhicule l’idée qu’on pourrait vieillir et rester jeune, qui est profondément absurde.
Pour vous cette idéologie tente de cacher un certain nombre de choses désagréables…
Evidemment ! C’est le refus de ce qui est souffrant, de ce qui est différent, et finalement de la mort elle-même. Par exemple, les produits de l’industrie cosmétique et pharmaceutique sont là pour le rappeler. On essaye de nous persuader que les rides sont honteuses et on nous propose des crèmes pour prévenir leur apparition. Mais est-ce mal d’avoir des rides ? Pas du tout : elles sont le condensé de notre histoire. Pour ma part, j’attendrais qu’une entreprise de produits cosmétiques ait le culot de nous dire : mettez vos rides en valeur, votre âge est beau, vous êtes beau car vous êtes vieux.
Qu’avez-vous voulu opposer à cette idéologie ?
La vieillesse est une période où l’on a désormais un suivi médical très intense. « Faites-vous suivre », nous dit-on. On encourage aussi l’exercice physique, le sport, on intervient jusque dans notre assiette. En d’autres termes le bienvieillir nous dit de « bien se comporter pour bien se porter ». Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est une tentative de normalisation des comportements des vieux, une volonté de les conformer à une norme, afin de ne pas déranger la société. Je pense qu’il y a là-dedans la manifestation d’une rancœur à l’égard de la génération issue de Mai 68, qui est détestée, car on dit qu’elle a bénéficié de tout : de liberté, d’un accès à l’emploi facile, d’argent.
Or on oublie que c’est aussi une génération qui a payé la reconstruction d’après-guerre, qui s’est mise en grève afin de gagner une cinquième semaine de congés payés et le passage aux 39h, puis aux 35h. Récemment, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a aussi vu beaucoup de vieux sur les ronds-points ! On a vu des vieux manifester ! Par conséquent, l’enjeu est là : il s’agit de faire peur au vieux, de normaliser leurs comportements, afin qu’ils ne se considèrent plus en état de jouer un rôle contestataire dans la société. Il faut s’opposer à cela.
« C’est le niveau de revenu qui doit servir de référence et non pas l’âge. »
Vous parlez d’ailleurs de la vieillesse comme « l’âge de la résistance ».
Tout à fait. On n’a pas la même puissance en tant que jeune qu’en tant que vieux, car c’est un âge où l’on ne risque plus grand chose. Le privilège de l’âge est de pouvoir prendre les risques que nos petits enfants ne peuvent pas prendre. C’est le temps de la mobilisation pour autrui, afin de faire advenir une société meilleure et de résister au changement lorsqu’il n’a pas de sens.
Vous dites que ce n’est que récemment que la vieillesse s’est construite comme objet de pensée à part. Comment cela est-il advenu ?
Ce nouveau statut de la vieillesse est l’effet d’une transformation sociétale très profonde : l’urbanisation et l’industrialisation. Jusqu’à la moitié du vingtième siècle, la France est un pays à dominante rurale, et le droit d’exploitation des terres appartient au membre le plus âgé de la famille. Après la guerre, avec la technicisation de la production agricole, il devient nécessaire d’acheter des engins agricoles. On se met alors à prêter non plus aux vieux – qui risquent de ne plus pouvoir rembourser – mais aux jeunes. S’opère alors une transmission du droit d’exploitation et de la propriété vers les plus jeunes, et avec elle une transmission du pouvoir. Cela marque une étape importante dans la mise à l’écart des anciens.
Par ailleurs, l’industrialisation et l’urbanisation de la société ont joué un rôle clé dans ce processus. Cela a profondément modifié et morcelé les unités familiales qui existaient dans la société rurale. Aujourd’hui, la mondialisation du marché du travail a accentué ce phénomène. Si je prends mon exemple personnel, mes deux enfants sont partis vivre loin de chez moi en raison de leurs obligations professionnelles. Désormais, dans notre société, nous n’habitons plus les uns auprès des autres, mais nous ne l’avons pas décidé. Cela s’est imposé. Par ailleurs, il n’est pas sûr non plus que la cellule familiale rapprochée soit idéale.
Justement, n’a-t-on pas tendance à idéaliser les « société traditionnelles » qui ostraciseraient moins leurs vieux ?
Il est évident que dans les sociétés dites « traditionnelles », les grands-parents, parents et petits-enfants vivent dans les mêmes unités de vie, ce qui limite l’isolement des vieux. C’est le cas dans beaucoup de pays du continent africain, par exemple. Cependant, les mêmes causes produisant les mêmes effets partout, l’urbanisation galopante et la transformation de l’économie touche aussi l’Afrique, et déstructure les familles.
J’ai eu l’occasion de me rendre compte de cela personnellement, lorsque je me suis rendu à Nouméa, où j’ai eu l’occasion de rencontrer des Kanaks vivant encore selon un mode de vie tribal. J’ai pu y discuter avec une dame d’une cinquantaine d’année qui avait dû placer sa mère dans une maison de retraite, car elle devait aller travailler loin de chez-elle, et ne pouvait plus s’en occuper. C’est un système économique dans son ensemble qui provoque l’isolement des personnes âgées.
Cela dit, il ne faut pas idéaliser l’habitat traditionnel, même si on peut en avoir une certaine nostalgie. Lorsque j’étais jeune, nous étions douze à la maison, avec trois de mes grands-parents. Ils étaient certes moins seuls, mais cela demandait beaucoup de travail à ma mère. Du point de vue de l’émancipation des femmes, ce pouvait être pesant.

Pensez-vous que nous vivons désormais dans une société jeuniste ?
Le terme « jeunisme » a un double sens. Son premier sens est « discrimination envers les jeunes ». Par exemple le fait de mettre en œuvre des dispositifs de valorisation de l’emploi des jeunes. Or pour ma part, il me semble que toutes les discriminations liées à l’âge son insupportable, qu’il s’agisse de traiter différemment quelqu’un au motif de son jeune âge ou de son vieil âge.
La carte senior – anciennement carte vermeil – est un exemple de discrimination en fonction de l’âge. Il s’agissait de favoriser le tourisme et le déplacement de nos contemporains les plus âgés. Cependant, cela nie les différences de revenus entre les âges ! Quel que soit votre âge, il est normal de payer si vous en avez les moyens, et de bénéficier d’une réduction si vous avez un niveau de revenu insuffisant. C’est le niveau de revenu qui doit servir de référence et non pas l’âge.
On a l’impression qu’il existe aujourd’hui un conflit entre les générations. Les jeunes reprochant au vieux l’état de la planète, par exemple, et les vieux critiquant les mœurs des jeunes. Pensez-vous que ce conflit de générations soit une réalité ?
La bonne question est : à qui profite l’opposition de générations ? Et l’on voit surtout qu’elle est souvent maniée par des hommes politiques. Certains tentent tantôt de récupérer un électorat jeune – en dévalorisant le vote des vieux sous prétexte qu’il ne représentent pas l’avenir – tantôt d’attirer l’électorat vieux en abordant des thématiques censées les séduire. On voit également la récupération mercantile qui a intérêt à cette opposition. Cela permet de créer un marché séparé. Par exemple, on crée des lignes de survêtements spécialement pour les vieux, comme si nous ne pouvions pas faire du sport habillés comme tout le monde. En résumé, il est problématique que l’âge devienne un critère premier. Comme je le dis dans mon livre : « Peut-être le problème est-il mal posé ; au fond, il ne s’agirait pas de vieillir, bien ou mal, mais d’abord de vivre. De vivre vieux, jeune, peu importe. »
Quel danger y’a-t-il à opposer les générations ?
On en arrive aujourd’hui à une « cotation de la vie », au terme de laquelle on attribue une certaine valeur à telle vie plutôt qu’à telle autre, notamment en fonction de l’âge. Pendant l’épidémie du Covid-19 que nous avons traversé, certaines personnes étaient même prêtes à laisser mourir des vieux pour préserver l’économie. Or l’âge ne peut pas être une manière de définir la valeur d’un homme.
La seule manière d’arriver à dépasser cela est d’imaginer une réciprocité de la reconnaissance. Il ne suffit pas de demander aux jeunes de reconnaître la pertinence des vieux, il faut aussi demander aux vieux de reconnaître la pertinence des jeunes. Si, sous le seul prétexte que je suis vieux, je critique tel aspect de la culture des « jeunes » je ne devrai pas m’étonner qu’ils me blâment. Si nous nous ouvrons à ce que vivent les jeunes, ils s’ouvriront à ce que nous vivons.
« Notre histoire familiale nous inscrit sur une terre. »
Malgré tout, du fait de leur âge, qu’ont les vieux à transmettre aux jeunes ?
Tout d’abord, nous devons leur transmettre une histoire. Une histoire familiale, qui s’inscrit dans une Histoire plus large. Cela est essentiel, car notre histoire familiale nous inscrit sur une terre. Plus nos enfants et petits-enfants seront touchés par la dispersion géographique causée par notre système économique mondial, plus ils auront besoin de savoir où ont poussé les racines qui les ont produits. Cette histoire familiale vous inscrit aussi dans une culture, caractérisée par une langue. À travers tout cela, c’est un patrimoine que nous transmettons, qui ne peut se réduire à un patrimoine financier ou foncier.
Cette inscription dans l’histoire sous-tend une logique d’humilité qui consiste, au fond, à reconnaître que d’autres étaient là avant nous, et que, pour une part au moins, nous leur devons ce que nous sommes. Nier cette dette, c’est se condamner à briser le lien de solidarité entre les générations, et plus globalement, le lien de solidarité.
Ne pensez-vous pas que la génération de Mai 68 a participé à cette rupture de la transmission, en voulant « tuer le père » ?
Ne nous trompons pas de registre. Cette génération mettait d’abord en question l’autorité politique. Mai 1968 était une opposition à un président que nous voulions remettre en cause. C’est aussi à cette occasion que le droit à l’IVG a été réclamé haut et fort par des femmes, ce qui est tout de même une avancée.
Transmettre la mémoire, c’est donc aussi par exemple transmettre la mémoire d’un tel événement ! Si nous ne le faisons pas, nos enfants croiront tout ce qui est raconté sur Mai 68, à savoir qu’il s’agissait essentiellement de la libération des mœurs et la libération sexuelle, ce qui est faux ! C’est un événement avant tout politique, qui a obtenu des avancées sociales. Nous devons transmettre ce désir de lutter à nos enfants. Pour les inciter à continuer à se battre pour leurs droits. Aujourd’hui, sur la question de l’environnement, ils se manifestent, et nous devons les y encourager. Nous avons un extraordinaire effort à faire pour conjuguer nos initiatives. C’est un registre dans lequel je crois qu’il est aisé de se retrouver.
Une manifestation caractéristique du refus de vieillir est la popularité du courant transhumaniste. Quel problème vous semble-t-il poser ?
Le transhumanisme tente de jouer avec l’essence de ce qui nous fait homme. Ce qui nous fait homme est de naître et de mourir. Faire croire à « la mort de la mort », comme le fait Laurent Alexandre, est une tromperie. Cela n’empêche pas de se réjouir des progrès de la médecine. Mais au fond, qu’est-ce que c’est que d’être homme ?
Dans le lien de transmission entre générations se joue cette question-là. Nos enfants doivent pouvoir nous interroger sur notre finitude, car à travers cela, ils nous demandent : d’où vient l’Homme ? Et parler de la mort, c’est aussi accepter d’ouvrir la question : où va l’Homme ? Il n’y a pas de réponse scientifique à cette question, seule la foi y répond. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle ne mérite pas d’être posée.
La mort, pour un enfant, n’est pensable que si elle s’incarne sur quelqu’un. Or, comment l’enfant pourrait-il penser la mort de ses parents ? Cela est trop douloureux. Alors que la mort des grands-parents est plus envisageable. C’est parce que l’enfant peut penser ma mort qu’il peut penser sa vie. Nous pouvons aussi regarder les questions environnementales ou sociales sous cet angle-là. Si nous, anciens, ne posons pas les conditions d’une vie respectueuse, si nous mettons en acte une destruction possible de la vie, comment l’enfant pourrait-il penser sa vie ?
- Fralib – Dix ans sans actionnaires - 05/30/1998
- Bernard Friot : « Un travail aliéné génère toujours du loisir aliéné » - 05/30/1998
- Michel Billé : « La vieillesse est l’âge de résistance » - 05/30/1998