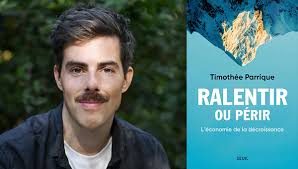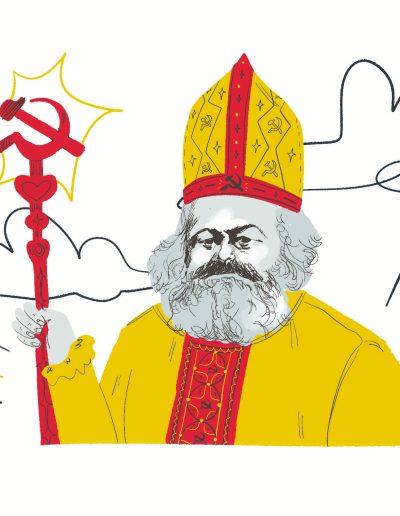Il y a un an, nous publiions dans la revue un long entretien d’Eugénie Bastié avec Sylvain Tesson. Le géographe et écrivain nous y livrait son plaidoyer pour la limite, à l’heure de l’apologie d’un progrès épileptique. Alors qu’août se meurt et que nous nous apprêtons à retrouver nos open spaces connectés, son éloge de la fuite tombe à point nommé.
– Il y a plein de choses que j’aimerais vous demander, mais la première, parce que qu’elle m’intrigue et me rapproche de vous, c’est celle-là : d’où vient votre passion pour la Russie ?
C’est d’abord l’expérience intime d’un cousinage mystérieux et affectif, le sentiment, lorsque je suis là-bas, d’être chez moi. Les Russes ont un comportement existentiel qui me ravit : une relative indulgence pour l’excès. Soit l’antipode de ce que l’on vit ici, où on a l’impression que nos hommes politiques sont obsédés par l’idée de nous domestiquer, de nous régenter, de nous royaumer dans nos comportements. On peut sans doute dire moins de choses en Russie qu’en France, moins en publier, mais on peut agir de manière plus débridée. La transgression est davantage tolérée. Je parle de la Russie des villages, rurale, entre l’Oural et Vladivostok. Ce qui me plaît aussi là-bas, c’est ce goût pour la force vitale et la capacité à ne pas toujours tout mesurer à l’aune de la dialectique entre l’oppresseur et la victime. Ce qui est un comble dans le pays qui s’est offert avec tant de fièvre au marxisme ! Quand il fait moins cinquante et que la bagnole ne démarre pas, ils ne se disent pas que c’est la faute de l’État ! S’il y a des congères devant l’école, le Russe prend une pelle. En Russie, forcé par la douleur des siècles, on est près de la vie, tout près. Enfin, il y a en Russie un rapport charnel, organique à la nature. J’ai un œil de géographe. Un paysage qui se déroule sur dix fuseaux horaires m’impressionne. Davantage, je l’avoue, que le jardin potager à la française dont je reconnais la minutieuse valeur, mais qui a perdu en sauvagerie ce qu’il a gagné en plate-bande. J’ai un goût pour ce que nous avons perdu : le même paysage invariable, intouché, qui s’étend sur des milliers de kilomètres.
– Il y a un paradoxe chez vous : vous êtes à la fois profondément inscrit dans une généalogie et une géographie françaises et en même temps irrésistiblement attiré ailleurs. Que cherchez-vous dans vos voyages ? Ou plutôt, que fuyez-vous ?
Mes voyages les plus récents (Les Chemins noirs, le Tibet) sont une tentative d’aller à la rencontre de ce qui n’est pas humain. Je ne place pas l’homme au sommet de tout. Je cherche des territoires où il n’est pas là. Je scrute les endroits où il ne peut faire que passer : la montagne, la paroi, les forêts, les steppes, les plateaux tibétains… Je fuis l’anthropisation du territoire. Je cherche le poème initial ce que l’on appelait, au XIXe siècle, les contrées « pré-adamiques ». Mais parfois, que voulez-vous, on est bien obligé de battre la campagne où l’homme s’est installé́. Alors, là, il convient de chercher « le terroir », c’est-à-dire un paysage fécondé lentement par l’homme, à l’échelle des millénaires. En de tels lieux, le paysan a signé un traité de paix avec le climat, le sol et l’écosystème. Mon père est picard, ma mère est du centre de la France. En France, marqueterie physique et kaléidoscope paysan, le moindre arpent de territoire a été décrit par un poète, peint par un peintre, labouré par un serf. C’est beau mais étouffant.
– Vous êtes un aventurier, mais aujourd’hui tout le monde rêve de l’être. Si tout le monde veut être Sylvain Tesson, n’est-ce pas la fin du voyage ?
Les zones qui échappent au déversement torrentiel du tourisme de masse existent encore. C’est ce que j’explique dans Les Chemins noirs (Gallimard, 2016) : il suffit simplement d’avoir de l’imagination, de travailler un peu, de chercher à sortir des sentiers battus. Il y a encore des interstices. Ça demande un peu d’effort, mais les échappées existent.
– Nous sommes dans une société qui proclame son libéralisme mais multiplie les interdits. Trouvez-vous notre société étouffante ?
La révolution numérique donne à tout le monde voix au chapitre. Vous n’avez rien à dire ? Hurlez-le ! Voilà ce que propose le dispositif numérique : un porte-voix qui prend davantage en compte le volume sonore que la valeur du propos. Il y a là une fable à caractère hydraulique : il faut s’imaginer les grands génies de la Silicone Valley qui ont installé autour du Globe terrestre des millions de kilomètres de tuyauterie et de câbles. Ce qui passera dedans ? Peu importe ! disent-ils. Des excréments ou de l’or, c’est la même chose ! Tout se vaut frères humains ! Voilà ce qu’ils proclament avec leurs outils technologiques qui sont l’incarnation de la pensée égalitariste. Moi, je viens de la civilisation d’avant: celle des sourciers, les hommes qui cherchaient l’eau avant de creuser les canaux. Autre chose que nous mesurons mal : cette technologie est une arme de dompteur. Elle rend service aux maîtres, elle permet la soumission des masses, elle place chaque être humain sous l’œil de Sauron, l’œil de Moscou, l’œil du geôlier, appelez-cela comme vous voulez. Je comprends que les hommes politiques travaillent à faire ruisseler le wifi partout. Ils se disent, le soir : « Connectons-les tous ! Cela les anesthésiera et nous les tiendrons à l’œil ». Je me permets une parenthèse, puisque je parle de nos dirigeants : ils me fascinent, ces hommes politiques. Ce sont des entomologistes ratés, trop mauvais en sciences pour faire de la zoologie, mais qui se passionnent pour la direction des masses. Ils voulaient être Maeterlinck, ils se sont contentés du conseil régional.
– Certes, mais aujourd’hui, justement, c’est le mouvement qui est devenu le mot d’ordre politique par excellence. En Marche! disent-ils…
Vous faites la distinction entre l’enracinement et la mobilité, les fondations et la fluidité, entre les nomades et la colline inspirée… J’aime l’analogie du port d’attache. J’arrive à lier en moi le sentiment d’appartenance profonde à un lieu, et l’appel du large. Je me sens profondément de quelque part, et j’aspire au voyage : voilà une dialectique que comprennent les bateaux à voile. Je ne suis pas dans la glorification du mouvement pour le mouvement, de l’agitation, du progrès, c’est-à-dire de l’épilepsie. Je glorifie le mouvement physique, organique, que l’évolution a minutieusement ajusté : le déplacement. La danse, l’escalade, la vitesse, le génie de la mobilité animale. Cela n’a rien à voir avec le nomadisme civilisationnel, qui consiste à errer de Starbucks café en zone piétonne commerciale. On peut très bien vénérer les cloîtres et les quais d’embarquement. Ce qui est intéressant, avec l’intelligence artificielle et le numérique, c’est qu’on voit que les robots remplacent plus facilement nos capacités mentales que physiques : on arrive à faire des robots champions en jeu de Go, mais pas des petits rats de l’opéra.
– La chair est plus difficile à reproduire que l’intelligence…
Il y a une intelligence du geste. Le rêve du globalisme marchand, c’est le mouvement généralisé du consommateur qui glisse d’une caisse à l’autre. C’est un cauchemar. Le mouvement que moi je prône exige un effort, une solitude, un recentrement par le déplacement. Ce qui est applicable à la patrie intérieure n’est pas comparable à ce qu’on voudrait promettre à une société toute entière.
– Outre le bruit et le mouvement, notre civilisation exige aussi une transparence absolue, et la fin de la vie privée… Est-ce cela aussi que vous fuyez ?
Dans mes livres, je raconte ma vie, mais je ne dis rien de moi. Je ne suis pas dans l’autofiction narcissique, je raconte des faits, des actions. Je suis effaré par l’idée de la vie transparente. Le goût occidental architectural nous emmène vers des bâtiments entièrement en verre. Il y a aussi les open spaces, la fin des cabinets dans les restaurants, les carrés dans les TGV. Le vis-à-vis imposé.
– Vous évoquez dans votre livre les ruines, les paysages, tout ce qui dure et qui échappe au mouvement. Vous n’avez pas de téléphone, pas de télévision, pas de profil Facebook. Vous considérez-vous comme un antimoderne ?
J’ai étudié la géologie, la géographie physique. J’ai un goût pour le substrat. Cela finit par renforcer chez moi l’impression de la fugacité du passage de l’homme sur la terre. Ce goût pour les pierres, les fondations géologiques, s’est transformé en goût pour les fondations culturelles. Quand on se passionne pour les pierres qui ont des millions d’années d’âge, on vénère ce qui demeure. Je m’intéresse très peu à ce qui est à venir. Je suis éberlué par les gens qui se passionnent pour l’innovation. Il n’y a rien de plus ringard que ce qui est innovant. Moi, je suis passionné par les invariants. Par exemple le sens de l’orientation chez des guides de montagne. Je trouve plus intéressant l’homme qui a une perception animale du terrain, plutôt qu’un GPS. Je préfère les intuitions aux algorithmes. Mais je suis optimiste. La supériorité de ce qui dure finira par triompher de l’agitation fétichiste.
– Vous vous définiriez comme un conservateur ?
C’est un mot qui n’est pas infâmant. La conservation, c’est le mot d’ordre de toute biologie. Nous sommes des êtres de conservation qui cherchons à nous maintenir en vie. Conservateur de musées, d’ailleurs, c’est un beau métier. Les adorateurs du progrès, eux aussi, sont des conservateurs: ils essaient de conserver leurs postes, leurs privilèges, leurs pouvoirs.
– Au niveau individuel, les comportements sont de plus en plus encadrés, standardisés, on recherche le confort et même le conformisme. Mais au niveau collectif, on ne cherche qu’à transgresser les grandes limites naturelles de l’homme, la mort, le vieillissement…Vous, c’est l’inverse !
Il faut distinguer les limites que l’on cherche à dépasser personnellement et le franchissement des limites globales institué comme principe de fonctionnement des sociétés. Moi, je franchis des limites physiques. Je n’en fais pas un mot d’ordre. Je me souviens d’une boite de montres pour grands sportifs qui avait pour slogan « no limit ». Tous les sportifs qui étaient financés par cette compagnie, parachutistes, plongeurs, sont morts. Le « no limit » a quelque chose d’adolescent. Normalement, quand on est jeune, on cherche à tester ses limites, et puis quand on les a trouvées, on s’assagit et on construit une vie. Très bizarrement, l’humanité suit la pente contraire : nous avions commencé par la sagesse (les Grecs) et nous allons vers la dinguerie. Clément d’Alexandrie, au IIe siècle, avait tout dit : « Contente-toi du monde ». L’horizon de l’humanité type Silicon Valley, c’est l’institutionnalisation de l’adolescence en modèle de vie. C’est une forme de sénilité. Plus le monde réel se dégrade, écosystémiquement parlant (50% des vertébrés des zones humides ont disparu), plus on se réfugie dans le virtuel. « Les nouvelles technologies vont arranger les choses », disent-ils. On se rêve autre chose, car on est incapables de se contenter du monde. On l’a salopé. Alors on cherche à aller sur Mars. Le fétichisme cybernétique est un messianisme. Internet, c’est un fusil dans les mains d’un singe. C’est un prétoire géant, un palais de justice global. Alors je cherche à prendre la fuite.
Vous pouvez retrouver la suite du dossier culturel « Un tour à la montagne » dans le numéro 11 de la Revue Limite. Pour recevoir les prochains numéros, n’hésitez pas à vous abonner !
- Sylvain Tesson « Moi, je viens de la civilisation d’avant : celle des sourciers, les hommes qui cherchaient l’eau avant de creuser les canaux. » - 05/30/1998
- Roger Scruton : « LE PROGRÈS EST UNE SUPERSTITION PERVERSE » - 05/30/1998
- «IL N’Y A RIEN DE PLUS RINGARD QUE CE QUI EST INNOVANT» SYLVAIN TESSON - 05/30/1998