Dans sa chronique hebdomadaire, « La Courte Echelle » (#LCE), Gaultier Bès revient sur l’actualité à l’aune de l’écologie intégrale. Tous les mercredi à 8h, 12h45 et 19h20, retrouvez également « La Courte Echelle » sur Radio Espérance.
De la bête au Boche
C’est un livre dérangeant qu’a publié en août dernier le jeune romancier Jean-Baptiste Del Amo, chez Gallimard. Règne animal interroge moins en effet la sauvagerie des bêtes que la nôtre, cette sauvagerie qui réside au sein même de la domestication animale.
Le roman raconte le destin d’une famille d’éleveurs du sud-ouest de la France sur plusieurs générations. Tout commence en 1898, dans la boue de la misère paysanne, et s’achève un siècle plus tard, en 1981, année de naissance de l’auteur, dans la boue de la misère industrielle. Entre ces deux dates, une famille qui se bat pour donner du sens à une vie brutale, fondée sur la violence quotidienne d’un élevage porcin. De la soue de la petite ferme où s’ébrouent quelques bêtes au hangar de l’exploitation où elles s’entassent par milliers, l’époque a changé, mais la famille est restée, et avec elle le poids d’une culpabilité enfouie.
Si le roman pèche parfois par une noirceur complaisante, il n’en demeure pas moins une fresque poignante, où se dessine un lien profond, archaïque, entre la violence qui règne entre les hommes et la violence qu’eux-mêmes exercent sur les animaux pour en tirer nourriture et profit.
La première guerre mondiale à laquelle participe l’un des membres de la famille est, à cet égard, un révélateur. Ainsi, au moment de la déclaration de guerre, le village est rassemblé devant la mairie : « Ils savent qu’il faudra tuer, ils savent, c’est un fait acquis, une certitude, une vérité, la raison même, il faut tuer à la guerre, sinon quoi d’autre ? Ils ont enfoncé des lames dans le cou des porcs et dans l’orbite des lapins. Ils ont tiré la biche, le sanglier. Ils ont noyé les chiots et égorgé le mouton. Ils ont piégé le renard, empoisonné les rats, ils ont décapité l’oie, le canard, la poule. Ils ont vu tuer depuis leur naissance. Ils ont regardé les pères et les mères ôter la vie aux bêtes. Ils ont appris les gestes, ils les ont reproduits. Ils ont tué à leur tour le lièvre, le coq, la vache, le goret, le pigeon. Ils ont fait couler le sang, l’ont parfois bu. Ils en connaissent l’odeur et le goût. Mais un Boche ? Comment ça se tue un Boche ? » (p. 129).
D’une guerre l’autre
A ce moment, ils ne savent pas s’ils sauront, mais il faut bien partir. Et avant le déchaînement de violence, c’est l’heure d’une dernière tendresse, puisqu’ils en sont aussi, ou encore, capables : « Ils entonnent une Marseillaise pour se donner du courage. Puis, ils boivent un dernier verre à la lumière des lampions, sous le vol bas et désordonné des chauves-souris. Ils regagnent les maisons. Ils bordent l’enfant endormi et posent une main sur son front moite. Ils étreignent le corps de l’épouse dans le lit conjugal ou celui de l’amante dans une grange à foin. Ils entrent dans l’étable, la bergerie, et observent les bêtes couchées. Ils goûtent leur odeur chaude et acre. Ils flattent le chanfrein des chevaux, le pis nourricier des vaches. Ils bercent un chevreau qui leur tête les doigts. Ils s’allongent dans le foin, contre le flanc d’une pouliche. Ils contemplent la nuit calme et limpide, le ciel ouvert sur les constellations ardentes. Ils écoutent le chant d’un hibou, la dispute criarde de jeunes martres dans le bois. » (p. 131).
Commence alors le grand massacre des hommes. Massacre mutuel, fraternel même, car ce sont bien des semblables, paysans ou artisans des deux côtés du Rhin, qui s’entretuent. Et ce massacre des semblables se double d’un autre massacre, celui des bêtes qu’on tue pour nourrir les hommes qui vont se faire tuer. La mort a le dessus. « Le rythme d’abattage est tel qu’aucun des hommes n’en a auparavant connu de semblable, même ceux qui, dans les villes, ont travaillé aux abattoirs. »
Et face à l’ennemi, car il paraît que c’en est un, la main non plus ne doit pas trembler. « Il arrive qu’un de ces éclats de métal arrache la tête d’un homme, et le corps de celui-là continue alors de cavaler droit devant, pareil aux canards que la veuve décapite et qui courent encore vers la petite mare à demi asséchée, pleine de fientes et de plumes, à l’arrière de la ferme. Lorsqu’un tirailleur allemand se montre à découvert devant lui, Marcel le met en joue. Il pense : c’est comme une bête, c’est rien d’autre qu’une bête, c’est une bête. » (p. 199). Le mépris des bêtes trouve son naturel prolongement dans les mépris des hommes, les unes comme les autres réduits à un matériau, une ressource à exploiter, chair à chicot ou à canon.
Marcel survivra, mais c’est une gueule cassée qui se couchera désormais, honteuse, furieuse contre le monde et contre soi, dans le lit conjugal. A la mort de sa belle-mère, cependant, une nouvelle ère s’ouvre : la vieille avait caché un petit trésor, patiemment prélevé, saison après saison, sur les maigres recettes de la ferme. La prospérité est-elle enfin arrivée, après des décennies de misère ? « Il achète deux jeunes truies et les met à l’engraissage ».
Horreurs et misères de l’élevage industriel
Les deux dernières parties se passent en 1981. Nouvelle génération, nouveaux modes de production : d’artisanal, l’élevage est devenu industriel. Mais c’est toujours la guerre qui règne au cœur de l’exploitation. « Car tout, dans le monde clos et puant de la porcherie, n’est qu’une immense infection patiemment contenue et contrôlée par les hommes, jusqu’aux carcasses que l’abattoir régurgite dans les supermarchés, même lavées à l’eau de javel et débitées en tranches roses puis emballées avec du cellophane sur des barquettes de polystyrène d’un blanc immaculé, et qui portent l’invisible souillure de la porcherie, les germes et bactéries contre lesquels ils mènent un combat qu’ils savent pourtant perdu d’avance, avec leurs petites armes de guerre : jet à haute pression, Cresyl, désinfectant pour les truies, désinfectant pour les plaies, vermifuges, vaccin contre la grippe, vaccin contre la parvovirose, vaccin contre le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin, vaccin contre le circovirus, injection de fer, d’antibiotiques, injections de vitamines, de minéraux, d’hormones de croissance, administration de compléments alimentaires, tout cela pour pallier leurs carences et leurs déficiences volontairement créées de la main de l’homme. »
Ce n’est pas que les personnages du roman soient particulièrement sadiques, ou qu’ils n’aiment pas leurs bêtes, c’est qu’ils ne savent pas faire autrement. Il faut bien répondre à la demande toujours croissante de viande à bas coûts. Il faut bien être compétitif. Ce n’est pas d’abord leur responsabilité individuelle qui est en cause dans cette horreur de l’élevage industriel que décrit Jean-Baptiste Del Amo. C’est d’abord celle d’un système productiviste qui transforme les hommes en machines et les animaux en usines à viande, seulement bonnes à produire, toujours plus et toujours plus vite.
La fin du roman ouvre, cependant, et heureusement, une brèche dans cette effrayante fatalité .Un animal s’échappe, et tout est rebattu. Je ne sais pas si le temps de la « libération animale » est arrivé, comme certains le proclament. Mais je sais qu’il est urgent de changer nos comportements alimentaires, en commençant pas manger beaucoup moins de viande, si nous ne voulons pas que continuent l’indigne exploitation des bêtes et l’intoxication accélérée des hommes par eux-mêmes. C’est l’un des mérites du roman de Jean-Baptiste Del Amo que de ne rien nous cacher de cette réalité qu’on s’obstine à ne pas voir.


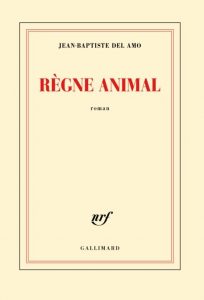



Superbe article. Un grand merci.