Bienvenue dans l’ère anthropocène ! L’avènement de l’homme comme force géologique signe le ravage du monde vivant et de ses équilibres. Mais avant d’être économique, le problème est philosophique. Généalogie d’un désastre.
L’homme, cette île flottante
Les modifications induites à la surface de la terre par les activités humaines sont devenues si importantes que leur ampleur dépasse celle des évolutions géologiques. La quantité annuelle de déchets dépasse désormais celle des sédiments produits par l’érosion.Aux racines du problème, bien avant la révolution industrielle, l’insularisation de l’être humain au sein du monde, caractéristique de la pensée moderne. « L’homme est le terme unique d’où il faut partir et auquel il faut tout ramener », écrit Diderot dans l’article « Encyclopédie » de son Encyclopédie. À quoi il ajoute : « Abstraction faite de mon existence et du bonheur de mes semblables, que m’im- porte le reste de la nature ? » Au nom de quoi, toutes les exactions se trouvent permises, voire recommandées. Avec une cécité stupéfiante : car comment imaginer que les hommes puissent être heureux dans un monde dévasté ?
La science moderne favorise une telle attitude. D’une part, parce qu’elle permet le développement de moyens techniques surpuissants qui, par leur démesure, détruisent tous les équilibres. D’autre part, parce que dans son principe même elle s’est rendue aveugle au vivant, trop mou sans doute pour ces sciences dures. Selon Galilée en effet, l’univers est écrit en langue mathématique. La physique moderne doit mettre au jour les structures mathématiques sous-jacentes aux phénomènes. Kant, à la fin du XVIIIe siècle, indexa le caractère scientifique d’une connaissance de la nature à sa mathématicité : « J’affirme que, dans toute théorie particulière de la nature, on ne peut trouver de science à proprement parler que dans l’exacte mesure où il peut s’y trouver de la mathématique » (Préface aux Premiers Principes métaphysiques de la science de la nature, 1786). Adieu veau, vache, cochon ; bonjour compas, mesures et fonctions !
Le sens de la vie
Il n’en fut pourtant pas toujours ainsi. En latin, natura désigne en premier lieu le fait de la naissance (« nature » et « nativité » ont la même racine). De même en grec, le terme physis vient du verbe phuô qui signifie naître, croître, pousser. La physique n’est pas d’abord science des nombres et de la matière, mais étude du vivant compris comme organisme capable de se reproduire. C’est donc très logiquement qu’Aristote cite en premier lieu, dans sa Physique, les animaux, les plantes, et seulement ensuite les corps simples comme la terre, le feu, l’air et l’eau. La nature n’est pas d’abord une question de ressources comptables, mais de bestioles grouillantes, possédant chacune leurs fins propres et leurs bizarreries, difficiles à mettre en équation.
Mais cela a-t-il un sens, même dans l’idéal, d’envisager réduire le vivant à une théorie mathématique ? Il est permis d’en douter. La vie et les mathématiques semblent même opposées. D’un côté, le vivant se présente toujours à nous comme poursuivant des buts qui lui sont propres, comme habité par une finalité. D’un autre côté, à l’intérieur d’une théorie mathématique, les explications téléologiques – explications par la finalité – n’ont pas leur place. La science moderne explique les phénomènes par leur cause, et non par leur finalité.
Si les êtres vivants ne sont plus que les produits accidentels de mutations génétiques aléatoires, il est logique qu’ils soient méprisés, manipulés et trafiqués par les scientifiques censés les étudier.
Olivier Rey
La girafe a survécu parce qu’elle était par chance dotée d’un long cou, mais elle ne possède pas un long cou dans le but d’atteindre les feuilles des arbres. Son cou n’a rien à voir avec les efforts qu’elle a fait pour s’adapter : c’est le produit d’un hasard, une pure variation statistique. Toute l’activité persévérante que le vivant déploie pour survivre sont par principe exclues du champ scientifique moderne. Comme l’a écrit le biologiste et prix Nobel de médecine Jacques Monod : « La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l’objectivité de la Nature. C’est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance “vraie” toute interprétation des phénomènes donnée en termes de causes finales, c’est-à-dire de “projet”. […] Il est impossible de s’en défaire, fût-ce provisoirement, ou dans un domaine limité, sans sortir de celui de la science elle-même. »
La fin des haricots
Si les êtres vivants ne sont plus que les produits accidentels de mutations génétiques aléatoires, il est logique qu’ils soient méprisés, manipulés et trafiqués par les scientifiques censés les étudier. Pourquoi en effet respecter l’intégrité d’un être à qui on ne concède pas plus de sens qu’à n’importe quel caillou ? Pourtant, précisait Monod, cette même objectivité « oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants, à admettre que dans leurs structures et performances, ils réalisent et poursuivent un projet » (Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biolo- gie moderne, 1970).
De là une position inconfortable, parfaitement résumée dans les années 1930 par le généticien J.B.S. Haldane : « La téléologie est pour le biologiste comme une maîtresse sans laquelle il ne peut pas vivre, mais avec laquelle il ne veut pas être vu en public. » Fondamentalement, on se trouve placé devant une alternative : ou bien le vivant en tant que tel peut être appréhendé par la science – mais alors le vivant, en tant qu’être capable de finalité, se dissout, ce n’est plus le vivant ; ou bien le vivant en tant que tel ne peut pas être appréhendé par la science (en son sens moderne), et… non, ce serait trop dur à admettre, cela obligerait à trop de remises en cause. Mieux vaut ne pas y penser. Le constat de François Jacob, formulé il y a un demi-siècle, est plus valable que jamais : « On n’interroge plus la vie aujourd’hui dans les laboratoires. On ne cherche plus à en cerner les contours. […] C’est aux algorithmes du monde vivant que s’intéresse aujourd’hui la biologie » (La Logique du vivant, Une histoire de l’hérédité, 1970). Voilà qui n’a rien d’étonnant, étant donnée la cécité structurelle de la science moderne au vivant. De la méconnaissance du vivant découle sa destruction. Peut-être le biocide commence-t-il là.


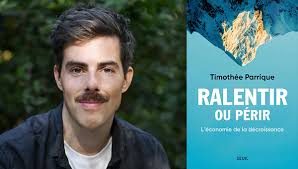
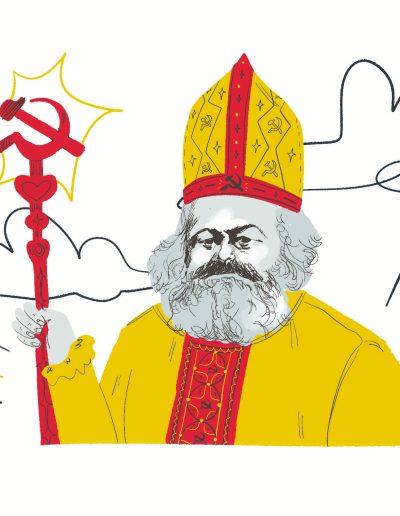

La lecture de Iain McGilchrist, The Matter with Things (2021), pourrait vous intéresser. Le sous-titre: Our Brains, Our Delusions, and The Unmaking of The World. Ce psychiatre et neuroscientifique explique magnifiquement et avec beaucoup de détails ce que vous résumez ici avec force.
« Si les êtres vivants ne sont plus que les produits accidentels de mutations génétiques aléatoires, il est logique qu’ils soient méprisés, manipulés et trafiqués par les scientifiques censés les étudier. »
Mutation ET sélection sur des milliards d’années. Si vous oubliez cela, la théorie scientifique paraît stupide.
Et c’est pour cela qu’un être humain mérite le respect, puisque c’est (du moins le cerveau) l’organisme le plus complexe jamais créé.