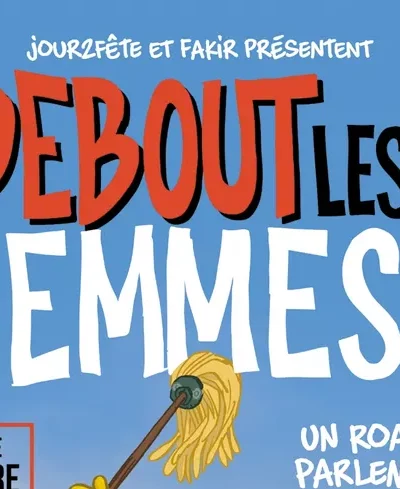François Esperet est un écrivain peu commun. 36 ans, marié, père de six enfants, chrétien fervent et converti, il a le cheveu poivre et sel, des tatouages religieux pleins les bras et le sourire sympathique. Il m’accueille un soir de novembre au Louis-Philippe, à deux pas de la mairie de Paris où il travaille comme administrateur civil.
La maison semble être la sienne, tous les serveurs le connaissent par son prénom. La patronne, discrète et chaleureuse, nous portera des bières à l’étage avec un respect plein d’amitié. On y croisera même Véronique Lévy.
Diplômé de l’ENS, il a ensuite passé les concours de la gendarmerie « pour retrouver la littérature » où elle se trouvait vraiment. Parachuté chef de bureau d’enquête, il avait déjà démantelé son premier réseau criminel à 24 ans et nocé avec des voyous. Autant de rencontres qu’il raconte dans « Larrons », le roman-poème magistral qui l’a fait connaître.
En 2014, l’auteur récidive avec « Gagneuses », une autre chanson de geste qui narre l’histoire de Franck Villon et de ses 6 putains tragiques. Les vers y sont tendres et les mots crus. Il nous fallait absolument rencontrer ce bloyen poète, où qu’il fût !
Vos personnages sont des criminels, des prostituées et des bandits. Vous en avez vu de près ?
Oui, d’assez près pour les connaître, les voir vivre et les entendre se raconter. Et c’est leur parole qui m’a accroché, séduit, aimanté : leur parole dérobée dans le cadre d’écoutes téléphoniques ou de sonorisations d’appartement, mais également leur parole offerte pendant les gardes à vue, et parfois partagée sur les chemins d’une amitié naissante. Elle avait quelque chose d’un art brut, d’un charisme d’autant plus puissant qu’il s’ignore. Ces personnes devenues personnages, je les ai connues et aimées par l’intermédiaire de leur parole, qui a contribué, avec la littérature et la poésie, à forger et libérer la mienne.
Vous adoptez un style très original, profondément épique, à la fois poétique et romanesque. Pourquoi ce choix d’écriture ?
Ce style, je l’ai découvert par surprise. Après avoir écrit mes premiers poèmes, publiés plus tard sous le titre de Sangs d’Emprunt, je me suis lancé dans ce qui devait être un poème de plus et qui est rapidement devenu le début de Larrons. Je me suis senti comme ces musiciens de bop qui se découvrent un souffle inépuisable dans Sur la route . J’avais trouvé ce que Kerouac appelle le it : mon style, mon rythme, ma transe. Avec Gagneuses, j’ai eu l’impression de vivre du même souffle, mais en le maîtrisant davantage. Et c’est ce souffle encore qui m’aide à écrire en ce moment un grand poème épique sur Jacob.
Mais dans les nombreux monologues de vos « Larrons », est-ce leur souffle ou bien le vôtre ?
Le leur devenu le mien. Le personnage du premier chant de Larrons par exemple, est un gars que j’ai rencontré au tout début, lorsque je suis arrivé comme jeune enquêteur dans la gendarmerie. J’avais 24 ans et j’étais chef de groupe. Lui, avait 45 ans, et il était voleur de bijoux. Je l’ai connu parce qu’on venait d’arrêter sa soeur. On a sympathisé et il s’est mis en tête de me faire découvrir les plus beaux endroits de Paris la nuit. Qu’on soit policier ou voleur, soldat d’un camp ou de l’autre, il faut et il suffit de commencer à se parler pour faire la paix. Et à l’inverse, comme Faulkner le montre superbement dans Parabole, la guerre ne vit et ne se nourrit que du silence et de l’isolement des combattants. Si les soldats se parlent et se tendent la main, immédiatement la paix advient – les généraux s’acharnant à empêcher l’éclosion de cette évidence qui menace tous les pouvoirs. Avec ce voleur, c’était donc davantage une histoire de paix qu’une histoire de pacte – comme d’ailleurs avec tous les autres. Le point commun des quatre Larrons dont j’ai chanté l’histoire, c’est que j’ai eu envie de sauver quelque chose d’eux, pas de les sauver, mais de sauver quelque chose d’eux : leurs cris, leurs invectives, leur empreinte dans le monde. De sauver leur langue, leur parole, qui était sans doute leur meilleure part.
À propos de votre poésie romanesque, on cite aussi bien Léon Bloy que Dylan. Qu’avez-vous appris de leurs oeuvres ?
Ils ont tous les deux une intuition très forte de l’efficacité de la parole et de son caractère surnaturel. Ils manient la parole littéraire et poétique d’une manière quasiment liturgique. De Léon Bloy, en lequel son filleul Jacques Maritain voyait magnifiquement, à l’opposé des sépulcres blanchis des Évangiles, « une chapelle noircie », je retiens la possibilité de mener de front une foi, une vie, une oeuvre littéraire, qui s’interpénètrent pour le meilleur et pour le pire. Il m’inspire donc autant en vie qu’en art, et il est présent dans mes prières comme j’espère l’être dans les siennes. Quant à Bob Dylan, il m’accompagne depuis que j’ai 17 ans. Il est ce roi David dont je lis et relis les psaumes pour y découvrir les grands et les petits mystères de l’existence – ce roi David dont la vie et l’oeuvre sont infiniment plus amples, plus profondes et plus complexes que ce à quoi beaucoup les réduisent : une victoire de jeunesse contre les philistins. Comme David, Bob Dylan est passé très jeune de l’anonymat au succès le plus éclatant. Comme David, il a insatiablement vécu, écrit et chanté, tombant pour mieux se relever, changeant pour mieux se retrouver. Comme David avec ses psaumes enfin, il incarne avec ses chansons cette humanité dont le Salut est inséparable de son péché : avec Salomon, c’est toute l’ascendance humaine du Christ qui est née d’un adultère et d’un homicide.
Quel regard sociologique portez-vous sur ce qu’on appelle « le milieu » ? A-t-il connu des ruptures depuis « le titi parisien » des films d’Audiard ? Quel regard portez-vous sur sa langue ?
Mon regard n’est jamais sociologique et je ne cherche pas à dominer conceptuellement le réel qui court partout autour de moi. Comme chacun, j’entends aujourd’hui les échos d’une gouaille qui tend à se transformer en marchandise, et comme chacun j’ai sous les yeux un milieu spectaculaire dont l’inauthenticité pour beaucoup tient lieu de réalité. Pour ce que j’en connais et pour ce que j’en aime, le véritable argot est une éloquence, et une éloquence viscéralement libre. C’est un syncrétisme intuitif et autoritaire qui abolit les frontières sociales et géographiques. Avec l’argot, la parole procure aux pauvres le bonheur et la liberté que leur refuse l’ordre établi.
Vous êtes recouvert de tatouages : cela remonte à l’époque où vous fréquentiez des bandits ? Vous pourriez nous les décrire ? 
J’ai commencé bien avant d’entrer dans la gendarmerie où les règlements continuent de proscrire les tatouages – en particulier quand ils sont religieux ! J’ai fait mon premier tatouage avec ma femme le jour de mes vingt ans : un point sur l’épaule comme un signe pour sceller notre engagement. Elle s’est arrêtée là et moi j’ai continué : avec les mains en prière de Dürer sur les flancs, la Trinité de Roublev sur le torse, le Sacré coeur de Georges Desvallières – qui est un des tableaux préférés de Léon Bloy, sur l’avant-bras gauche, et le Christ de Saint Jean de la Croix sur l’avant-bras droit – mais également les inscriptions beat et holy sur les poignets – comme un signe à cette sainteté paradoxale redécouverte et chantée par Kerouac et Ginsberg. C’est un artiste américain installé à Paris, Karl Marc, qui les a presque tous faits. Ils sont pour moi autant de serments prononcés devant Dieu, ma femme, et quelques rêves de jeunesse. « Mets-moi comme un sceau sur ton coeur, comme un sceau sur ton bras », dit la bien-aimée du Cantique des Cantiques : c’est ce que je fais avec ce qui m’est le plus essentiel.
Quand on est pauvre et exclu, est-ce que vous pensez qu’on n’a le choix qu’entre la misère et le banditisme ?
Le banditisme n’est pas que cela, mais il est un choix. Il l’est moins que ce que les voyous prétendent, et plus que ce que les sociologues imaginent. L’aliénation et la liberté tissent paradoxalement la vie des bandits comme celle des picaros dans Guzman. Et finalement comme toute vie, où le péché et la grâce cohabitent. Il n’y a là rien à expliquer, ou à débattre. Comme l’a écrit Bob Dylan dans une de ses plus belles chansons Well, God’s in heaven / and we all want what’s his / but power and greed and corruptible seed / seem to be all that there is. Je ne me demande jamais si les gens que je rencontre ont choisi ou subi la vie qui a fait d’eux ce qu’ils sont à cet instant. Et j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à rencontrer des gens qui ne se posaient pas et qui ne me posaient pas non plus la question de savoir ce qui m’avait amené là où j’étais.
Est-ce qu’il faut « éradiquer la pauvreté » par tous les moyens, comme on le pense à l’ONU ?
Là encore, je n’ai pour vous répondre que quelques intuitions. D’abord, avec Léon Bloy je fais la distinction entre la misère, qui est privation du nécessaire et qui isole, et la pauvreté, qui est privation du superflu et qui rassemble. Dans cet esprit je me méfie des grands projets d’éradication de la pauvreté qui pavent le chemin de l’enfer de leurs bonnes intentions et qui aboutissent souvent à une lutte impitoyable contre les pauvres – en particulier contre ce qu’ils possèdent en propre, c’est-à-dire ce qui relève du vernaculaire. Cette lutte contre les pauvres, Ivan Illich a su en montrer les mécanismes en mettant à jour le ressort impérialiste et belliqueux du développement obligatoire. Je partage sa méfiance face à toutes les forces dites progressistes qui se donnent pour mission d’éradiquer le monde ancien et qui voient dans la pauvreté une arriération. Pour reprendre une terrible formule de Karl Kraus, je me méfie donc particulièrement, sur la question de la pauvreté, du «progrès sous les pas duquel l’herbe prend le deuil et la forêt devient papier et qui a subordonné les raisons de vivre aux moyens qui permettent de vivre, faisant de nous les vis auxiliaires de nos outils ». Cette pauvreté que le Christ a revêtue et dont il a fait la porte d’entrée pour accéder au Royaume, il me semble qu’il nous faut chrétiennement l’atteindre et non l’éradiquer. Je ne parle pas de la misère qui abîme et défigure l’humanité. Je parle de la pauvreté, et de ce que Jésus-Christ nous en dit. Chrétiennement, ce n’est pas la pauvreté le problème à résoudre. C’est la richesse. Qui d’ailleurs n’est pas sans lien avec la misère…
Vous avez déjà éprouvé la haine du pauvre, qu’évoque Patrick Declerck dans sa remarquable thèse sur « Les Naufragés de la vie » ?
Comme chacun, j’ai éprouvé cette haine du pauvre qui tient sans doute à la fois à la peur de le devenir et à la honte de ne pas l’être. Mais avec l’écriture, et l’écriture du chrétien particulièrement, il s’agit, sans rien effacer de ce qui est haïssable, de discerner ce qui est aimable. Il s’agit, pour reprendre une belle intuition d’Ernest Hello, de deviner et d’aimer, et de sauver ce qui peut l’être. Je vois et je dépeins le mal à l’oeuvre dans la vie de mes personnages. Mais même quand il est à son paroxysme je le sais incapable d’effacer en eux la frappe indélébile de Dieu. Le mal existe, mais il n’élimine jamais la possibilité du bien. Celui qui prostitue sa femme, évidemment, commet le mal et le fait commettre. Mais sa femme, qui peut dire pour autant qu’il ne l’aime pas ? J’ai été le témoin de ce mystère et dans Gagneuses j’ai essayé de le dépeindre avec le recul et la médiation de l’écriture, de la langue, et le passage du temps. De mon rapport littéraire au misérable, au déviant, au criminel, je dirai qu’il ressemble beaucoup aux sentiments qui animent James Agee dans l’écriture de Louons maintenant les grands hommes – à mes yeux un des chefs-d’oeuvre de la littérature américaine.
Vous avez déclaré un jour que le spectacle médiatique permanent nous interdit d’avoir des sentiments authentiques. Comment fait-on aujourd’hui pour cultiver des sentiments vrais ?
Comment fait-on pour retrouver la santé ? On arrête de s’empoisonner. Il faut donc commencer par se débrancher de tous les médias, de tous les inputs qui font rentrer en permanence le pire dans nos esprits, nos âmes et nos coeurs. Je me suis rendu compte que les journées de l’année où je suis le meilleur écrivain, le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami, le meilleur prochain de mon prochain, c’est celles où, pour une raison ou pour une autre, je ne me suis laissé informer de rien. La privation des médias, tout le monde la craint et pourtant jamais personne n’en est mort. Pour cultiver des sentiments vrais, il faut arracher les sentiments faux semés comme l’ivraie avec le bon grain. Et ces sentiments faux n’émanent pas uniquement de ce que seraient les mauvais médias par opposition aux bons. Ne perdons pas trop de temps à séparer les bons médias des mauvais, comme les bonnes drogues des mauvaises – attachons-nous à être libre et tout le reste nous sera donné par surcroît.
Vous nous avez appris en début d’entretien que vous étiez devenu orthodoxe – pouvez-vous en quelques mots nous en dire plus sur cette conversion ?
Il s’agit d’une mue spirituelle plus que d’une conversion – parce qu’à mes yeux ma seule conversion, c’est ma conversion au Christ et elle date de plusieurs années. De mon point de vue, je n’ai rien perdu ni renié de ma foi catholique, au contraire. Au sens du Credo, je dirai même qu’étant orthodoxe je me sens plus et mieux catholique qu’avant. Il y a plus d’un an et demi, sur les conseils d’un moine catholique, j’ai commencé à faire la prière du nom de Jésus, connue aussi sous le nom de prière du coeur et popularisée par les récits d’un pèlerin russe. J’ai suivi le fil de mon chapelet et il m’a amené à lire les pères de l’Église, ainsi que les grands théologiens orthodoxes. Et pendant plus d’un an, chaque nouvelle découverte spirituelle, intellectuelle, liturgique, théologique m’a été révélation ou confirmation d’un pressentiment. Après une longue période de discernement, je suis devenu orthodoxe et depuis le mois de septembre c’est au séminaire russe d’Epinay-sous- Senart que je communie dans la joie tous les dimanches. L’évangélique père Alexandre Siniakov y fait grandir et y partage, avec ses séminaristes, les trésors d’une orthodoxie universelle et lumineuse.
- FRANÇOIS ESPERET : « L’ARGOT C’EST LE BONHEUR DES PAUVRES » - 05/30/1998
- THE BENEDICT OPTION - 05/30/1998
- TRIBUNE : « MICHEL ONFRAY, DÉCADENCE D’UNE IMPOSTURE » - 05/30/1998