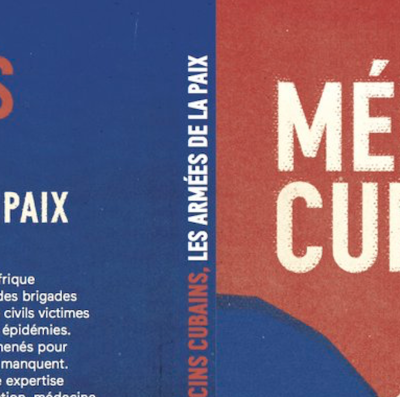On ne se préoccupe de notre santé que lorsque celle-ci nous fait défaut. Celle-ci est particulièrement remise en cause ces jours-ci. Entre confinement et « gestes barrières », notre santé se réduit-elle à du gel hydroalcoolique et un masque?
La santé, c’est de ne pas s’en préoccuper. Elle est comme l’air qu’on respire, le sol sous nos semelles, le don de la vitalité qui nous tourne vers toutes les choses – cette œuvre, cette femme, cet enfant – mais ne nous retourne pas vers lui-même. Seul un malade est inquiet de sa santé, et sur ce point je sais beaucoup de bien-portants qui sont malades. Par prévention, par frilosité, ils multiplient les check-up, surveille leur convivialité, ne cessent d’interpréter les diagrammes de leur être explicité en trente-six paramètres. Une société focalisée sur le bien-être physique est une société moribonde.
Nietzsche le déclare, étendant cette obsession du bien-être à celle du « bonheur » : « Le désir du “bonheur” caractérise les hommes partiellement ou totalement “malvenus”, les impuissants ; les autres ne songent pas au “bonheur”, leur force cherche à se dépenser. » De même que le sol est pour que nous le cultivions et y dégagions un chemin, la santé n’est pas pour elle-même, mais pour le déploiement de la vie humaine, de la bonté jusqu’au sacrifice. Et c’est pourquoi les gens en bonne santé meurent davantage et mieux que les malades. Ils se jettent dans l’aventure, ne regardent pas aux coups reçus, pourvu qu’ils servent le bien, et voilà qu’ils crèvent à la tâche et au champ d’honneur – prématurément, diront en tremblant les retraités précoces.
Pour la même raison héroïque, le sens de la maladie peut s’inverser : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », ce qui me condamne au grabat pourrait bien m’élever. Arraché à l’activisme et au divertissement généralisé, entrant dans ce coming-out du consommateur-salarié qu’on appelle aussi burn-out, il m’est donné de réfléchir. Le physique est au plus mal, le moral est à zéro, mais c’est qu’il faut aller vers le métaphysique et chercher l’infini. D’où la célèbre prière de Pascal « pour demander à Dieu le bon usage des maladies » : « Vous m’avez donné la santé pour vous servir, et j’en ai fait un usage tout profane. Vous m’envoyez maintenant la maladie pour me corriger : ne permettez pas que j’en use pour vous irriter par mon impatience. J’ai mal usé de ma santé, et vous m’en avez justement puni. Ne souffrez pas que j’use mal de votre punition. Et puisque la corruption de ma nature est telle, qu’elle me rend vos faveurs pernicieuses, faites, ô mon Dieu, que votre grâce toute-puissante me rende vos châtiments salutaires. »
Nietzsche pourrait rétorquer à Pascal qu’on retrouve bien là le mensonge du christianisme : celui-ci a besoin que la terre aille mal, incurablement, pour que l’on n’ait plus d’autre issue que de se vouer au ciel. Et il est vrai que ce dualisme du ciel et de la terre – ou de l’âme et du corps – a fait long feu. Mais, sur le fond, Pascal et Nietzsche convergent : la santé est un point de départ, non d’arrivée ; elle est pour une dépense d’amour à mort.
Dans la VIème partie du Discours de la méthode, lorsque Descartes parle de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature », il fournit ce motif, à l’opposé du dualisme qu’on lui impute ordinairement : « [Cette maîtrise] n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ; car même l’esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que, s’il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusques ici, je crois que c’est dans la médecine qu’on doit le chercher. »
Cette affirmation semble nous situer à l’orée du transhumanisme : chercher les gènes du Q.I. supérieur afin de les ajuster dans l’œuf au moyen de l’imprononçable « CRISPR/Cas9 » (crispeur casse-neuf ?), n’est-ce par réaliser le projet de « rendre les hommes plus sages et plus habiles » en modifiant « la disposition des organes du corps » ? Mais on remarque aussi que ce dont il s’agit de se rendre « comme maîtres et possesseurs » n’est pas tant la Nature à l’extérieur de nous, que la nature en nous, dans la suite des Règles pour la direction de l’esprit, afin d’être meilleurs dans l’ordre de la sagesse et la vertu, et non de la physiologie.
Descartes soutient donc que la santé est le bien fondamental, mais refuse lui aussi de la considérer comme le bien final. Le fondement est pour qu’on construise un édifice. Que l’édifice manque, que l’on ne s’applique jamais qu’aux fondations, cela ne sert de rien, et l’on n’est pas plus ici sous son toit que dans un désert. La question est de comprendre comment on peut si bien marcher sur la tête que la base devient le sommet, ou le fondement, la finalité ultime.
Il se peut que cela ait trait aux guerres de religion. On a peur de se disputer sur l’essence du Souverain Bien, alors on se contente de fraterniser autour de ce bien commun évident : la santé. L’athée et le croyant peuvent adhérer ensemble à la nécessité d’une opération de la cataracte. Le roi très-chrétien et l’émir saoudien peuvent chercher de conserve des remèdes contre le cancer, et se serrer la main, non seulement grâce à la solidarité dans le pétrole, mais aussi à la fraternité dans la biologie, qui les pousse à co-financer la recherche d’une radiothérapie à neutrons rapides.
La santé met tout le monde d’accord. Et c’est pourquoi les « meilleurs vœux » de Nouvel An insistent : « Et la santé, surtout ! » Car, sans cette précision, on pourrait redouter les « meilleurs vœux » d’un catholique fervent. Ils risqueraient de nous mener plus directement à la croix.
Quand on est assez en forme pour assister à une pièce de Molière, il est normal de penser que tous les médecins sont des charlatans
En même temps, lorsque j’entendis pour la première fois les membres d’une communauté charismatique brésilienne me lancer : « Meilleurs vœux de sainteté ! », j’en ressentis comme un malaise. C’était aller un peu vite en besogne. Cela avait quelque chose d’obscène, comme si, dans un autre contexte, voyant une jolie femme à mon bras, on nous souhaitait sans détour de magnifiques orgasmes.
Je dois le confesser aujourd’hui : mépriser la santé était un luxe de ma jeunesse. Bien sûr, je la récuse toujours comme sommet, mais je la chéris comme base, indubitablement. Ce que je peux écrire ici dépend encore du fait que je ne suis pas au lit avec 40 de fièvre. Quand on est assez en forme pour assister à une pièce de Molière, il est normal de penser que tous les médecins sont des charlatans ; mais, dès que ça va mal, on assume pleinement le ridicule de les appeler à son chevet.
Il y a aussi que j’ai une femme et des enfants. Ma vie les concerne de telle sorte que je ne peux plus courir comme cela au martyre. Je suis le père de famille qui attend qu’un Maximilien Kolbe se substitue à lui. Je pourrais négliger ma santé si ce n’était que pour moi-même, mais, pour eux, je dois en prendre soin, sans quoi ce serait abandonner mon poste, manquer à mon devoir d’état. Il faut que je sois assez en forme pour panser celui qui se blesse, aider celui qui a demain une interro de latin, gagner la subsistance commune. Aussi ai-je promis de faire un check-up complet pour mes 50 ans, afin de blanchir encore sous le harnais.
Enfin, souhaiter la santé, c’est reconnaître et conserver la liberté de l’autre. On veut pour lui la force de chercher et d’adhérer personnellement à la vérité. Quant à soi-même, on se voue à une grande patience. Si j’adresse mes meilleurs vœux de santé à mon adversaire, j’accepte d’endurer encore ses attaques, ou du moins que son bras reste assez vigoureux pour me faire mal – ou se convertir au bien. J’imagine, au 1er janvier, une victime présenter ses vœux de santé à son bourreau, avec un naïf sourire. Il se pourrait bien que ce souhait de fortifier son bras soit aussi ce qui le désarme.
La médecine apparaît aujourd’hui comme une avant-garde du paradigme technocratique. Léon Daudet dénonçait déjà en 1894 (il avait 27 ans) l’emprise des « morticoles ». Et Léon Bloy, faisant l’exégèse des lieux communs, n’oubliait pas de commenter « La médecine est un sacerdoce » : « Un docteur qui flaire trente ou quarante pots de chambre de Bourgeois et qui palpe leurs viandes intimes, tous les matins, avant son déjeuner, a une autre allure, on est forcé d’en convenir, qu’un missionnaire annonçant la parole de Dieu à des idolâtres mal élevés qui le mangeront peut-être après son discours, et le libellé d’une ordonnance est bien autre chose, n’est-ce pas ? qu’un mandement épiscopal ! Auprès des gestes tâteurs, tripoteurs, auscultateurs des médecins ou en comparaison de leurs formules isochrones et stéréotypées, tombant de si haut, qu’on est toujours sûr d’entendre, que deviennent, je le demande, les canons et les liturgies ? »
Les ornements blancs de la blouse promettent des convalescences qui prennent la place de la foi en la résurrection. Et l’on peut en conséquence penser, avec Artaud, que la médecine est la maladie majeure de notre temps, et mettre en évidence, avec Illich, la tragédie de la Némésis médicale.
Ce serait toutefois commettre une grave erreur (médicale, encore, puisque ceux qui attaquent la médecine se posent toujours comme des médecins, et souvent des médecins improvisés ou autoproclamés, qui ont de surcroît la présomption de remédier aux maux de tout l’organisme social). La médecine, dans son essence, est la technique qui s’oppose le plus à la technocratie, et c’est pourquoi cette dernière, afin d’établir son empire, la corrompt en premier.
En effet, rien n’est plus voilé aujourd’hui que l’essence de la médecine. Et en dégager à nouveau la vérité est une tâche on ne peut plus salutaire, puisque la notion même de salut et de moyens du salut dépendent de l’analogie médicale. Le Christ lui-même se sert de cette analogie : Sans doute m’appliquerez-vous ce proverbe : Médecin guéris toi toi-même […] Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler au repentir les justes mais les pécheurs (Lc 4, 23 et 5, 31-32).
La médecine vise la santé. Or qu’est-ce que la santé ? Un don de la nature. Il ne s’agit donc pas d’une production humaine : son équilibre est constitutif de l’humain dans la plénitude de sa forme. Aussi la médecine ne guérit pas. Elle soigne, c’est-à-dire qu’elle écarte ce qui empêche notre vitalité intrinsèque de se déployer. À la fin, c’est la nature en nous qui reprend le dessus, de sorte que toute guérison est une auto-guérison. De fait, si la guérison était le produit de la médecine, nous ne serions jamais guéris, puisque notre équilibre dépendrait de sa constante médication.
Le grand mensonge techno-capitaliste vient de là : nous faire accroire que la médecine est cause principale et non seulement adjuvante de la santé, prétendre que la guérison est une performance technologique, et donc une prestation monnayable, innovante et incontournable, qui doit se changer en assistance permanente pour être plus profitable à l’industrie pharmaceutique. L’idée est qu’on ne peut vraiment bien marcher qu’avec des béquilles. Ou que, pour que ça roule, il faut la dernière chaise roulante électronique. Le transhumanisme est l’idéologie du handicap pour tous.
Dans son essence, la médecine résiste à cette marchandisation de la vie. Elle offre au patient de renouveler en lui le don de la nature. Elle est tout le contraire d’une dépendance. Elle opère un rétablissement. Elle contribue à rendre à autrui son autonomie. Sous ce rapport le médecin est comparable au missionnaire qui se fait manger après son discours. Il a permis la guérison, et voici son ancien patient qui caracole, rayonne, se porte comme un charme, à tel point qu’il charme la femme du docteur et part convoler avec elle.
Comme l’observe Hans-Georg Gadamer dans son « Apologie der Heilkunst – Apologie de l’art de soigner » : « Ce qui ressortit à l’art médical, c’est la santé, c’est-à-dire le naturel par excellence. Cela donne à l’art médical dans son ensemble son caractère propre. Il n’est ni invention, ni mise en place de quelque chose de nouveau qui n’existerait pas sous cette forme et que quelqu’un aurait eu le pouvoir de fabriquer de manière conforme. Il est d’emblée un mode de faire et d’agir qui ne fait rien en propre et de lui-même. Sa science et son savoir-faire se conforment entièrement au mouvement de la nature de sorte qu’en tentant de rétablir ce dernier dès qu’il est sujet à un trouble, ils se fondent en quelque sorte avec l’équilibre naturel de la santé. »
L’interprétation de Gadamer s’inscrit dans la suite d’Aristote et de Thomas d’Aquin. Ce dernier distingue deux types d’art, ceux dont la forme dérive entièrement de l’artisan, et ceux dont la forme dépend d’un principe intérieur, que le principe extérieur vient seulement seconder (Somme de Théologie, I, 117, 1, Respondeo) : « Ainsi la forme d’une maison est produite dans la matière uniquement par l’art de l’architecte. Mais la santé est causée chez le malade tantôt par un principe extérieur, qui est l’art médical, tantôt par un principe intérieur, comme lorsqu’on est guéri par la force de la nature. Quand elle est causée par l’art médical, il faut observer deux points. D’abord, que l’art imite la nature dans sa manière d’agir ; en effet, la nature guérit le malade en altérant, en digérant, ou en expulsant la matière qui cause la maladie ; c’est ainsi que l’art médical opère. Ensuite, il faut observer que le principe extérieur, c’est-à-dire l’art, n’agit pas de la même manière que l’agent principal, mais comme un auxiliaire qui seconde cet agent principal et intérieur en le fortifiant, et en lui procurant les instruments et les secours dont la nature se sert pour produire ses effets ; c’est ainsi que le médecin fortifie la nature et lui procure les aliments et les remèdes qu’elle emploie pour atteindre elle-même sa fin. »
On pourrait à vrai dire distinguer trois types de technè selon leur rapport à la nature : 1° La technique de l’artisan, qui impose une forme à un matériau naturel. 2° La technique du paysan, qui accompagne et améliore le développement d’une forme naturelle. 3° La technique du médecin, qui aide au simple rétablissement de la forme naturelle telle qu’elle est spécifiquement donnée.
Là où l’agriculture cherche encore des améliorations (races d’élevage, roses et radis domestiques, les unes plus belles, les autres plus comestibles et nombreux), la médecine se contente d’une pure restauration. Elle est l’art le plus proche de la nature, et sous ce rapport le plus emblématique pour l’écologie. Son ministère est de faire réaccueillir une donation originaire, qui la précède depuis toujours.
La médecine est un art sans œuvre propre. Elle n’est pas un « pouvoir de fabriquer », mais un « pouvoir de rétablir », et dont l’efficience s’accomplit donc en dernier lieu dans une abdication : c’est un faire qui coïncide avec un laisser-faire, une technique qui ménage sa place au dynamisme de la nature, et qui se retire, comme une parenthèse, comme si elle n’avait rien fait, parce que la santé ne vient pas essentiellement d’elle et que la victoire du médecin est précisément que la patient lui tourne le dos et l’oublie en filant vers de nouvelles aventures.
Gadamer présente l’efficacité médicale comme une humilité et une énigme : « Le médecin ne peut se retrancher derrière son œuvre comme peut le faire tout artiste, tout artisan et tout homme de savoir-faire qui, dans le même temps, fait en sorte que cette œuvre reste d’une certaine manière son œuvre. Cela vaut, il est vrai, pour toute technè : le produit est livré à l’usage des autres mais reste, cependant, une œuvre personnelle. En revanche, l’œuvre du médecin, précisément parce qu’elle est le rétablissement de la santé, n’est plus sienne du tout ; elle n’a même jamais été sienne. Le rapport entre l’acte et le produit, entre le faire et le fait, entre l’effort et le succès est ici d’une nature fondamentalement différente, énigmatique et problématique. »
Le Lys dans la vallée, livré, respiré et critiqué par d’innombrables lecteurs, reste une œuvre de Balzac. Mais la santé de Madame de Mortsauf, si elle est pleinement rétablie, n’est plus à rapporter à son médecin. Les efforts de celui-ci ne visaient pas à imposer son empreinte ou sa signature, bien au contraire, ils visaient à ne plus dépendre de sa force, et à permettre à Henriette d’être Henriette, dans sa vie libre et singulière. Le faire médical est un faire place (à l’autre, par la nature de l’autre). Qu’au nom de la « santé à tout prix », il se dénature en devenant exclusivement une technoscience produisant elle-même un équilibre connecté, il ne s’agit plus de soigner des patients, mais d’inventer des cyborgs, et le médecin doit céder le pas à l’ingénieur.
La médecine, comme art le plus proche de la nature, constitue un modèle pour tout art respectueux de sa source, spécialement l’art littéraire. Je vois là l’explication du génie d’Anton Tchekhov, de son « naturel », de sa bonté au bistouri, où l’humour ne se dépare jamais d’une profonde miséricorde. Il est écrivain comme il est médecin. Son théâtre, ses nouvelles font entièrement place à la vie telle qu’elle se donne, merveilleusement, incompréhensiblement, dramatiquement.
Fabrice Hadjadj
- Fabrice Hadjadj : quand l’outil sort de l’ombre - 05/30/1998
- A LA SANTE DE LA MEDECINE, LE GRAND EDITO DE FABRICE HADJADJ - 05/30/1998
- 3 DIPLÔMES DE PERDUS, UNE VIE DE RETROUVÉE - 05/30/1998