Poursuivant son analyse des soubassements idéologiques de la science moderne, notre ami Olivier Rey, chercheur au CNRS, vient de publier un nouvel essai important, Leurre et malheur du transhumanisme (DDB, octobre 2018). Avec son érudition et sa clarté habituelles, il nous révèle ce que le marketing transhumaniste cherche à dissimuler derrière sa vitrine mirobolante : l’homme « augmenté » n’est que le produit d’un monde ravagé.
Le transhumanisme, défi du siècle, ruse de guerre ou écran de fumée ?
Les trois, mon capitaine ! C’est la force du livre d’Olivier Rey de ne pas se contenter de rendre compte du discours transhumaniste en tentant de le déconstruire plus ou moins efficacement. Son ambition est plus haute : il cherche à montrer en quoi cette vision du progrès est dans la droite ligne du projet de soumission industrielle de la nature qui caractérise la modernité occidentale. Et c’est le désastre écologique en cours, ce divorce croissant d’avec la nature, qui prépare et provoque le « désir transhumaniste ». Ainsi, oui, le transhumanisme – que je préfère appeler le post-humanisme, ou, mieux encore, avec Pièce et Main d’œuvre, l’inhumanisme – est l’un des enjeux du siècle, sinon du millénaire. Mais cela, moins en tant que nouveauté radicale qu’en tant que prolongement logique d’un progrès devenu fou, fou de lui-même, et qui, nouveau Narcisse, risque de se noyer dans ses propres effets.
Ainsi, oui, le transhumanisme – que je préfère appeler le post-humanisme, ou, mieux encore, avec Pièce et Main d’œuvre, l’inhumanisme – est l’un des enjeux du siècle, sinon du millénaire.
Et c’est justement cette noyade que, selon Olivier Rey, le transhumanisme tend à dissimuler. C’est, sinon son projet, sa fonction, du moins l’une de ses conséquences. « Au nom d’un futur toujours meilleur », le développement productiviste a fait du monde un « chantier permanent » – une décharge, même, de moins en moins favorable à la vie. Bien sûr, si la plupart d’entre nous avions sérieusement conscience de cela, nous ferions en sorte de freiner, voire d’arrêter le massacre. Le transhumanisme non seulement nous endort, nous hypnotise, mais nous séduit et nous agrège. D’où l’idée de « leurre » : « La perte de confiance dans le progrès doit être compensée par des promesses exorbitantes ». Comment résister en effet, depuis son quotidien médiocre et insensé, aux sirènes de l’immortalité ? Comment ne pas être tenté de croire – car il s’agit bien d’une croyance – que la Technique nous sauvera quand la Nature semble à bout de souffle ? Le transhumanisme, providence sans transcendance, est d’autant plus attrayant qu’il flatte notre ego puisque cette fois, c’est nous-mêmes, par nos propres moyens, qui arrachons le feu des mains des dieux, vainquons la mort, repoussons les limites de notre condition biologique. Ainsi, loin de nous révolter contre une logique auto-destructrice, nous remettons une pièce dans la machine infernale.
Ainsi, loin de nous révolter contre une logique auto-destructrice, nous remettons une pièce dans la machine infernale.
Mais l’auteur met en valeur un autre effet du transhumanisme, plus insidieux : en focalisant l’attention médiatique, il détourne les citoyens techno-critiques d’une situation présente déjà en soi largement problématique. Et Olivier Rey de citer Jacques Ellul : « Ce n’est jamais que la vieille ruse de guerre : on simule une grande attaque, avec trompettes et lumières, de façon à attirer l’attention des défenseurs de la citadelle, cependant que la véritable opération (creusement d’une mine par exemple) se situe tout à fait ailleurs et se déroule autrement. » (Le Système technicien, 1979). Nous sommes tellement sidérés par ce que nous annoncent les bateleurs de la Silicon Valley que nous en oublions le caractère absurde, insupportable ou insoutenable de bien des conditions de notre existence actuelle. « Pendant que l’on discute des promesses extrêmes [et parfois fantaisistes] du transhumanisme, on se laisse docilement enserrer dans une toile bien réelle, aux mailles de plus en plus serrées ». Autrement dit, Scylla nous fait perdre de vue Charybde.
La politique de la terre brûlée
Le premier chapitre, intitulé « Faut-il prendre au sérieux le transhumanisme ? », montre comment ce discours impose peu à peu sa marque dans le débat public. Trois stratégies complémentaires et successives sont à l’œuvre :
- 1) l’« enchantement » : « Faites-nous confiance, laissez-nous faire, et vous n’aurez plus jamais soif, ni faim, ni froid, ni mal, et vous ne serez plus jamais seul » ;
- 2) la banalisation : « Rien de nouveau sous le soleil, l’être humain a toujours cherché, depuis l’invention de la roue jusqu’à celle de la fission nucléaire, à accroître son pouvoir sur le monde et à s’émanciper des limites de son état naturel » ;
- 3) la fatalité : « De toute manière, que vous le vouliez ou non, l’évolution de la science, de la biosphère et de la société impose de telles évolutions ; il est illusoire de penser qu’on puisse revenir en arrière, ou arrêter la marche de l’Histoire, mieux vaut encadrer les excès plutôt que de combattre en vain ce qui est déjà là… ».
Cette espèce de résignation évoque le there is no alternative libéral – qu’Olivier Rey appelle ici « l’argument de la terre brûlée ». Il cite ainsi Ray Kurzweil, futurologue transhumaniste et directeur de l’ingénierie chez Google : « Après tout, il reste trop peu de nature pour que nous puissions y retourner, et il y a trop d’êtres humains. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes rivés à la technologie » (The Age of Spiritual Machines : When Computers exceed Human Intelligence, 1999). L’image est révélatrice : nous sommes « rivés » à la technologie, simple pièce dans un engrenage qui nous dépasse, boulon serré par quelque « main invisible ».
Cette espèce de résignation évoque le there is no alternative libéral – qu’Olivier Rey appelle ici « l’argument de la terre brûlée ».
L’auteur ne manque pas de souligner que le même phénomène se produit à l’occasion avec les révisions régulières des lois dites de bioéthique. Notamment avec l’artificialisation de la procréation dont les discours de légitimation ont suivi ce processus :
- 1) L’émancipation : « un enfant quand je veux, comme je veux », redoublée d’une apparente compassion : « Dès lors que c’est techniquement possible, au nom de quoi priver des gens du bonheur d’avoir des enfants ? » ;
- 2) La normalisation : « La parenté biologique n’est qu’une construction sociale, il y a toujours d’autres manières d’avoir des enfants » ;
- 3) L’état de fait : « De toute manière, c’est légal ailleurs ».
Et, là aussi, la suite annoncée rend le présent presque anecdotique : face à l’ectogenèse, l’insémination artificielle apparaît bien innocente. Ainsi peut s’expliquer le battage médiatique actuel autour de la GPA, nouvelle transgression qui, en monopolisant l’attention, désarme l’opposition à la généralisation de la PMA sans père, rendue presque anecdotique par rapport à la légalisation des mères porteuses.
Les comités d’éthique en prennent d’ailleurs pour leur grade, eux dont la raison d’être n’est pas de « faire respecter quelque limite que ce soit », mais « seulement de régler la vitesse de l’évolution afin de donner l’impression à l’opinion que tout est mûrement réfléchi et ‘strictement encadré’ »…
À suivre…

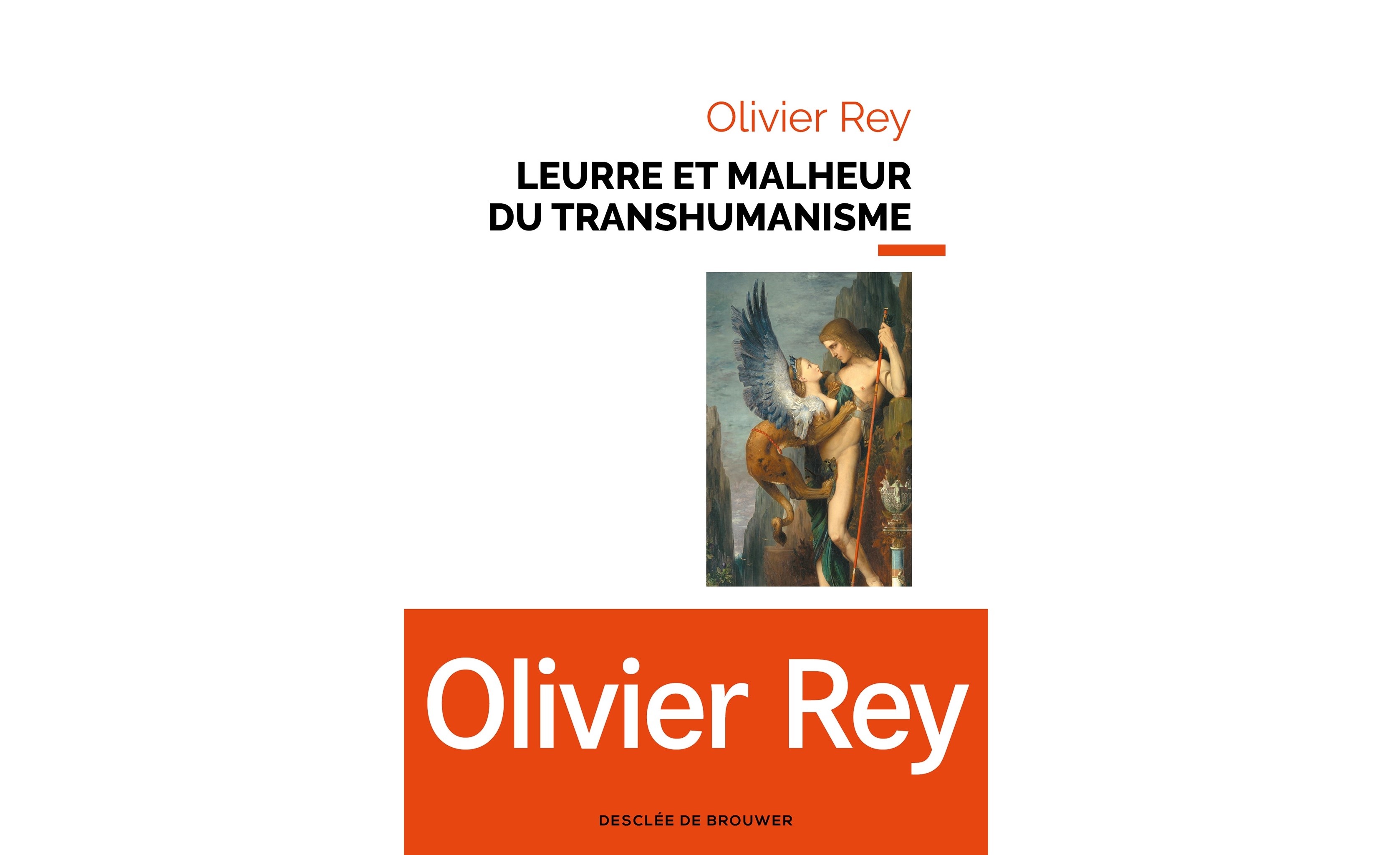



Totalement d’accord mais il y a en plus la question de notre dépendance totale de la nature, en particulier pour les GAFA qui sont dans l’utopie ! Or l’histoire a montré que les transgressions ont toujours mené à des catastrophes !
Même l’intelligence artificielle a besoin d’eau et d’énergie !
Pas un seul argument valable. Résumons:
1. Le transhumanisme est une conséquence de phénomènes que l’auteur déplore. Passons sur le fait que ces phénomènes sont une condition nécessaire au transhumanisme, mais que la réciproque est fausse. Surtout, à ce jeu-là, le mouvement écologiste aussi découle du progrès technique et de la crise écologique. Un mal n’engendre-t-il que des maux?
2. Une mystérieuse noyade narcissique et prométhéenne est le projet, la fonction ou peut-être la conséquence du transhumanisme – l’auteur ne sait pas trop. On attend un reproche argumenté qui ne viendra pas.
3. Le transhumanisme focalise l’attention médiatique. Si une bonne loi focalise l’attention médiatique au détriment d’une mauvaise loi, cela la rend-il moins bonne? Voilà une nouvelle objection qui n’est absolument pas propre au transhumanisme.
4. Certains partisans du transhumanisme s’appuient sur trois arguments… que l’auteur ne réfute pas. Le fait que ces types d’arguments puissent s’appliquer à PMA – ou à l’agriculture, du reste – n’apporte rien.
Remplacez « transhumanisme » par « progrès » dans tout l’article et il n’a ni plus ni moins de sens.
Bonjour,
Peut-être ceci pourrait-il vous intéresser…
https://www.youtube.com/watch?v=kBCDU_PnavQ
Cordialement